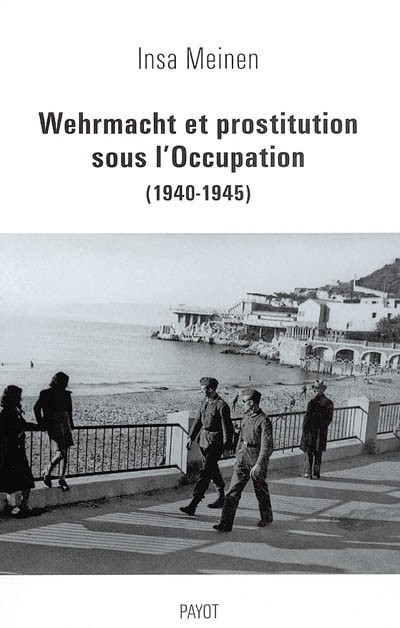Pendant la Seconde Guerre Mondiale, de vastes zones de l’Europe sous domination allemande furent dotées d’un système organisé de bordels à l’initiative de la Wehrmacht.
À peine les Allemands avaient-ils fait leur entrée dans Paris, que le Haut Commandement de l’Armée de Terre (okh) donna l’ordre d’installer des bordels spéciaux pour les officiers et les soldats sur l’ensemble du territoire français occupé.
Le bordel de la Wehrmacht entra dans le quotidien de l’occupation au même titre que la librairie du front et le foyer du soldat.
Il ne représentait que l’un des axes d’un catalogue exhaustif de mesures destinées à réglementer les relations sexuelles entre les troupes d’occupation et la population civile féminine.
L’action de l’administration militaire à l’encontre des femmes des couches populaires soupçonnées de proposer des services sexuels ou d’entretenir des contacts non contrôlés avec des membres de la Wehrmacht fut au moins aussi importante.
Les poursuites contre les prostituées et les Françaises soupçonnées de prostitution allèrent jusqu’à l’envoi en camp d’internement.
Repérées et poursuivies sur la seule base de leur fréquentation des soldats allemands, ces Françaises n’ont pas eu un rôle important dans le déroulement général de la Seconde Guerre Mondiale et elles n’ont pas eu non plus bonne réputation.
Pourtant, elles furent soumises à des contraintes policières et médicales qui visaient exclusivement les femmes.
La dimension spécifiquement sexuée de la conduite de guerre et de la politique d’occupation allemande n’est à ce point flagrant dans aucun autre domaine d’autant que l’administration militaire accordait une attention considérable au contrôle de la prostitution.
Par ailleurs, une des particularités du système des bordels de la Wehrmacht était de permettre aux membres d’une armée qui menait une guerre d’anéantissement à l’Est, d’avoir accès à des femmes et de leur proposer des compensations sexuelles.
Ceci est d’autant plus net dans le cas de la France occupée que le commandement militaire allemand voyait dans la France voisine une zone de détente pour les troupes du front de l’Est.
Nous évoquerons d’abord la façon dont les autorités d’occupation ont réglementé la prostitution et procédé contre les Françaises qui tenaient compagnie de façon gratuite ou payante aux soldats allemands.
Puis nous examinerons la question des raisons et des orientations en vertu desquelles la Wehrmacht s’est efforcée de contrôler les contacts de ses troupes avec les femmes dans la France occupée entre 1940 et 1944.
Le thème "Wehrmacht et prostitution" n’ayant pratiquement fait l’objet d’aucune étude scientifique.
Il faut citer en premier lieu le traité de vulgarisation..., les développements qui suivent s’appuient sur des documents de la Wehrmacht et de l’administration de Vichy tirés des archives allemandes et françaises.
Services compétents
La surveillance de la prostitution relevait du service de santé de la Wehrmacht. Les instances supérieures des bureaux sanitaires de l’okhédictaient, de Berlin, les instructions générales relatives au système des bordels et aux poursuites contre les femmes suspectées de prostitution, en France et dans les autres pays d’Europe sous domination allemande.
La responsabilité de leur mise en œuvre concrète revenait principalement aux unités sanitaires de l’administration d’occupation allemande, c’est-à-dire plus précisément aux officiers de santé affectés aux Feldkommandanturen.
La Feldgendarmerie, c’est-à-dire la police militaire, avait des attributions complémentaires liées à la répression de la prostitution.
A partir du début de l’été 1942, lorsque la SS reprit les attributions policières de l’administration militaire, les représentants de la Gestapo entrèrent eux aussi en action.
Toutefois, les officiers de santé continuèrent à assurer le rôle dirigeant.
Pour le contrôle des relations sexuelles comme pour les autres domaines de la politique d’occupation, l’administration militaire s’appuya sur la coopération avec les autorités de Vichy.
Les institutions policières françaises et les inspecteurs départementaux de la santé assurèrent une part essentielle de l’exécution des mesures de contrôle imposées par la Wehrmacht.
Les ordonnances berlinoises de juillet 1940
En juillet 1940, dès le deuxième mois de l’occupation donc l’okhpromulga deux directives ordonnant la mise en place de bordels de la Wehrmacht et la poursuite des prostituées sur l’ensemble du territoire français sous occupation allemande.
Ce fut le médecin militaire de l’okh qui, le 16 juillet 1940, sous l’intitulé "prostitution et bordels dans la zone occupée de la France" édicta des ordonnances générales et fixa la ligne directrice suivante :
"Tous les moyens doivent être mis en œuvre […] pour empêcher tout rapport sexuel avec des personnes de sexe féminin non soumises à un contrôle sanitaire".
Le principal instrument préconisé pour faire obstacle à ces contacts indésirables était le bordel. Le texte invitait à réquisitionner les bordels existants pour les soldats allemands.
Cette volonté de réglementation des autorités sanitaires allemandes du commandement en chef de l’armée de terre se concrétisa ensuite par un vaste catalogue de dispositions détaillées sur la gestion des bordels militaires, où les prescriptions policières et médicales côtoyaient les mesures de politique raciale.
On peut lire textuellement dans une instruction :
"Les prostituées de race juive et d’autres races étrangères sont à écarter".
Ces obligations détaillées n’étaient certes pas encore accompagnées de l’ordre express d’établir des bordels militaires dans l’ensemble de la zone d’occupation. Le même mois, le 29 juillet 1940, le quartier-maître général à l’état-major général de l’armée de terre signait une ordonnance imposant la sélection et la réquisition de bordels français pour la Wehrmacht. Elle prescrivait aussi la fixation de tarifs afin de soumettre la formation des prix au pouvoir discrétionnaire allemand.
L’ordonnance contenait également des directives concernant la poursuite des femmes soupçonnées de prostitution qui prolongeaient et élargissaient la pratique déjà introduite à cette date par les autorités d’occupation en France.
L’okh chargeait l’administration militaire en France de faire enregistrer immédiatement toutes les prostituées par les autorités sanitaires françaises et de coopérer dans ce but avec la police française.
Afin d’imposer le bordel comme le lieu des rapports sexuels entre les femmes autochtones et les occupants, l’ordonnance stipulait en outre l’interdiction de toute prostitution de rue par des moyens de police.
Dès la mi-juillet 1940, le service sanitaire de l’armée de terre posa ainsi les principes d’une réglementation uniforme de la prostitution par l’administration militaire sur la totalité du territoire occupé.
Le commandement allemand ordonnait non seulement la sélection et la réquisition, la puissance occupante, de certains bordels partout en France et leur surveillance par les bureaux de l’armée, mais il intervenait aussi dans le détail de l’organisation des maisons, des conditions de travail, du contrôle et des gains des femmes employées dans les bordels.
Si on cherchait ainsi à fixer dans quels lieux et dans quelles conditions les autochtones auraient des rapports sexuels avec les soldats allemands, l’instruction complémentaire de sélectionner le personnel selon des représentations raciales prescrivait aussi qui devait travailler dans les bordels réservés à la Wehrmacht.
Le fait que, dès juillet 1940, l’okh entreprenne de peser sur le contrôle de la prostitution dans la France occupée a donc une double portée.
D’une part, comme les ordonnances évoquées le montrent, la mise en place des bordels militaires reposait sur une planification centrale et des instructions du haut commandement militaire.
D’autre part, Berlin prit des mesures qui débouchaient sur une sorte de "bordel-standard d’occupation".
Cette centralisation et cette standardisation du système des bordels inauguré par la Wehrmacht se démarquent radicalement de la réglementation de la prostitution dans la France de l’avant-guerre.
L’okh exporta ainsi vers la France la réglementation introduite en 1939 dans le Reich allemand lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Le point de départ était visiblement une ordonnance prise le 9 septembre 1939 par Reinhard Heydrich, le représentant d’Heinrich Himmler, et qui prévoyait l’organisation administrative d’un système de bordel, ainsi que, conséquemment, la limitation et la criminalisation de la prostitution hors bordel dans les régions où opérait l’armée allemande.
Sur la répression, insuffisamment.... Ces dispositions furent étendues au territoire français occupé, assorties de quelques dispositions complémentaires, telles que, par exemple, l’interdiction faite aux Français de fréquenter les bordels de la Wehrmacht et la fixation des tarifs.
Sur la base des directives de Berlin, les autorités de l’occupation allemande instituèrent, au cours des mois suivants, un système de bordels et de prostitution qui, dans ses traits principaux, était en place à la fin de l’été 1940 et qui allait se maintenir jusqu’à la libération de la France en 1944.
Les poursuites contre les femmes soupçonnées de prostitution
A quoi ressemblait concrètement cette surveillance ?
Immédiatement après leur arrivée, les Allemands organisèrent une chasse en règle contre les femmes soupçonnées de prostitution.
Les unités de la Feldgendarmerieentreprirent, avec la police des mœurs française, des rafles et des descentes dans les rues, les cafés et les hôtels. Dans le même temps, les officiers de santé se lancèrent dans la recherche de ce qui fut appelé les "foyers de contagion".
Ce qui signifie que les soldats trouvés porteurs de maladies vénériennes furent invités à indiquer les femmes avec lesquelles ils avaient eu des rapports sexuels.
Les personnes ainsi dénoncées furent immédiatement arrêtées par la police. De nombreuses Françaises qui avaient fréquenté des soldats allemands furent ainsi repérées.
Ces poursuites concernèrent en partie des Françaises qui gagnaient leur vie en offrant leurs services sexuels. Mais elles frappaient aussi des femmes des couches populaires arrêtées dans des cafés suspects ou en compagnie d’Allemands, ou bien qui travaillaient dans des logements et des entreprises allemandes.
Les femmes ainsi interpellées furent examinées de force et, le cas échéant, soignées de force et enregistrées dans les fichiers de la police. En cas de récidive, elles étaient enregistrées comme prostituées et soumises à une surveillance médicale et à des contrôles policiers rigoureux.
Si elles enfreignaient les dispositions prises à leur encontre ou contractaient une maladie vénérienne en travaillant avec des membres de la Wehrmacht, les autorités allemandes les expulsaient vers des régions où aucune troupe allemande n’était stationnée, ou les faisaient emprisonner.
Les mesures par lesquelles les médecins militaires allemands visaient conjointement à contrôler les relations sexuelles et à satisfaire les besoins des troupes allemandes avaient pour caractéristique commune l’emprisonnement des femmes qui, par la volonté des officiers de santé, ne devaient pas avoir de contact avec les soldats allemands.
Sous l’occupation allemande, l’emprisonnement des prostituées, qui relevait depuis le XIXèmesiècle du contrôle administratif de la prostitution, prit une dimension quantitative et qualitative nouvelle.
On le voit notamment dans l’enfermement par l’administration militaire des "filles soumises" et des Françaises soupçonnées de prostitution non seulement dans des prisons, des hôpitaux et des maisons de redressement.
Mais, à compter de l’automne 1941, les Allemands ont également employé une forme d’enfermement qui caractérise aussi le régime de Vichy et qui est perçue comme la quintessence du pouvoir national-socialiste : le camp d’internement.
Nous illustrerons les mesures d’internement prises dans le cadre de la surveillance de la prostitution par l’exemple de deux camps situés dans le centre de la France. Il s’agit du camp de Jargeau dans le département du Loiret, où furent envoyées, à partir d’octobre 1941, au moins trois cent-trois femmes soupçonnées de prostitution, et du camp de La Lande dans le département de l’Indre-et-Loire.
Dans celui-ci, soixante-quatre prostituées furent détenues par les autorités allemandes entre novembre 1942 et décembre 1943.
Les sources qui nous sont parvenues montrent que l’internement de ces femmes dans ces camps fut principalement réclamé par les officiers de santé allemands.
Parmi les internées se trouvaient des femmes simplement soupçonnées de s’être livrées à la prostitution et d’autres qui avaient travaillé en tant que "filles soumises en carte", ou "pensionnaires" dans les bordels de la Wehrmacht et qui avaient enfreint les consignes des officiers de santé, s’étaient enfuies des hôpitaux ou avaient contracté une maladie vénérienne au contact des soldats allemands.
Une des rares possibilités de ressortir du camp de Jargeau
était d’entrer dans un bordel militaire.
Les prostituées internées pouvaient se porter candidates à ce travail.
Les occupants décidaient alors eux-mêmes des prisonnières qui pouvaient être transférées dans un bordel.
Cette association entre camp d’internement et bordel révèle l’empreinte typiquement nazie du contrôle administratif de la prostitution.
La contrainte liée au recrutement à l’intérieur du camp, la sélection et le placement par les Allemands des candidates au travail dans les bordels constituaient l’expression d’un proxénétisme administratif et d’une répression administrative de la prostitution sans équivalent dans l’histoire française.
Dans le même temps, le principe de base de la gestion de la prostitution par la Wehrmacht ne s’exprime nulle part avec autant de clarté que dans l’association camp-bordel car, ce faisant, l’administration militaire imposait de façon radicale sa volonté de décider dans quelles conditions et quelles Françaises auraient des rapports sexuels avec des membres de la Wehrmacht.
Les bordels de la Wehrmacht
Le système de bordels de la Wehrmacht n’était pas comparable aux maisons closes françaises traditionnelles.
Certes, les occupants pouvaient partiellement recourir aux bordels déjà existants que la Wehrmacht avait réquisitionnés à leur intention.
Mais dans le même temps, les médecins militaires allemands, qui assuraient ainsi indéniablement des fonctions de proxénètes, créèrent un grand nombre de nouveaux bordels en réquisitionnant des immeubles et en engageant des tenancières.
La nouveauté était surtout la planification et la surveillance, ordonnées par les autorités militaires de Berlin.
La frénésie réglementaire allemande s’incarnait en outre dans la différenciation des clientèles.
A côté des bordels spéciaux pour les soldats et pour les officiers, les occupants installèrent ainsi des bordels réservés respectivement aux sous-officiers, aux employés civils allemands et au personnel de l’organisation Todt.
La dimension quantitative du système était tout sauf négligeable, comme le montreront quelques exemples chiffrés.
En novembre 1941, la puissance occupante gérait ainsi à elle seule dans la zone d’administration militaire A – soit à peu près le tiers de la zone Nord sous occupation allemande, hormis Paris – cent-quarante-trois bordels où travaillaient mille cent-soixante-six femmes.
À Paris, on peut identifier au total quarante bordels réquisitionnés par les Allemands pendant l’occupation, auxquels s’ajoutent au moins douze bordels militaires en banlieue. Deux autres exemples : dans le Loiret, on comptait au total, dix bordels allemands ; en Charente-Maritime, au moins trente.
Des milliers de Françaises travaillaient dans ces bordels.
Ainsi, au cours de l’année 1942, dans la seule ville de La Rochelle, au moins deux-cent soixante et une femmes travaillaient dans les maisons réservées aux occupants..
Les soldats allemands fréquentaient massivement ces lieux. A Angers, par exemple, les autorités d’occupation qui tenaient une "statistique des bordels" enregistrèrent, de février 1941 à février 1942, par mois en moyenne plus de huit mille clients dans les cinq à six bordels militaires de la ville.
Calcul sur la base des statistiques disponibles,....
|
Objectif, justification
et arrière-plan
de la démarche allemande
|
Quelles intentions conduisirent la Wehrmacht à mettre en place des bordels et à poursuivre les Françaises suspectées de prostitution ?
Quelles mentalités furent ici à l’œuvre ?
Au cœur de l’esquisse qui va suivre, trois aspects : premièrement, la politique démographique et sanitaire de surveillance de la prostitution par les Allemands, deuxièmement, le contrôle des relations sexuelles entre soldats allemands et femmes françaises, et troisièmement, la participation des soldats allemands aux fruits de la victoire. Un autre aspect important que nous ne pourrons qu’évoquer rapidement ici sera l’image de la France et des femmes chez les occupants.
Maladies sexuelles et politique démographique
Un aspect central pour la compréhension du système de bordels de la Wehrmacht qui est en même temps le plus déconcertant, est son caractère de politique sanitaire.
Il s’exprime, par exemple, dans le fait que l’administration militaire allemande, dans ses rapports officiels, traite du contrôle de la prostitution sous la rubrique "épidémies" et que les médecins-chefs militaires désignaient explicitement les bordels de la Wehrmacht comme des "institutions de prévention des épidémies", et définissaient dans le même temps les femmes comme des "agents d’infection" potentiels.
Il nous faut donc nous demander pour quelle raison la Wehrmacht traitait les relations sexuelles des soldats Allemands avec des Françaises d’abord comme un problème d’hygiène épidémiologique et renvoyait l’organisation des relations sexuelles dans le territoire occupé à la "lutte contre les maladies sexuelles".
Il est tout aussi nécessaire d’expliquer pour quelle raison la Wehrmacht percevait les affections des organes génitaux comme une menace particulièrement sérieuse pour les capacités individuelles, comparativement à d’autres maladies, au point de prendre des mesures préventives en ce domaine et d’en faire un des thèmes principaux d’intervention de ses officiers de santé.
L’attention extrême portée à la prévention des maladies sexuelles par l’administration militaire allemande s’explique par le lien entre objectifs militaires à court terme et objectifs de politique démographique à long terme.
Il s’agissait bien évidemment pour la Wehrmacht de limiter les maladies chez ses soldats afin de les maintenir bons pour le service.
Mais en même temps, elle considérait les cas de gonorrhée et de syphilis chez ses soldats comme une menace pour "le corps de la nation".
Le service de santé des armées s’inscrivait ainsi dans une conception des maladies vénériennes comme élément de la politique de population qui s’était largement répandue au niveau international avant la Seconde Guerre Mondiale.
Comme nous le savons depuis les recherches pionnières d’Alain Corbin, dès la fin du XIXème siècle, sous l’influence du darwinisme, la recherche médicale avait lié les maladies vénériennes aux pronostics de dépopulation et à la théorie de la dégénérescence, et mis ainsi en évidence son importance supposée aussi bien pour la quantité que pour la prétendue "qualité" de la population.
Au premier plan se trouvait la théorie erronée de l’hérédité de la syphilis qui rendait cette maladie responsable de bon nombre de maladies et de phénomènes de déviance sociale.
Il était extrêmement courant, dans l’Allemagne des premières décennies du XXème siècle, d’évoquer les dangers supposés des maladies vénériennes pour le développement de la population.
Le gouvernement national-socialiste élu en 1933 fit (comme on le sait) de l’eugénisme un axe de sa politique.
La conception démographique des maladies vénériennes se concrétisa ainsi de façon exemplaire dans le droit matrimonial nazi et dans la pratique des stérilisations forcées.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle modela aussi les mesures de prévention médicale de la Wehrmacht.
Le service de santé allemand ne faisait pas seulement de la lutte contre la syphilis et la gonorrhée un objectif destiné à conserver la troupe en état de poursuivre des objectifs militaires.
Les médecins militaires concevaient bien plus les cas de maladies vénériennes chez les soldats allemands comme un danger pour la nation allemande. Ils se référaient ainsi à un concept de maladie tourné vers le futur, où les maladies vénériennes tenaient une place spécifique et primordiale.
La phobie de la contagion des occupants était renforcée par l’image négative de la France chez les Allemands et par les représentations stéréotypées qu’ils avaient des Françaises.
Pour les Allemands, la France n’était pas seulement le pays de l’amour et des jeux sexuels, mais aussi, précisément, la terre de la contagion, de la prostitution incontrôlée et du risque de contamination, où d’innombrables Françaises vérolées menaçaient la santé des soldats allemands.
Comme le montrent les documents allemands qui nous sont parvenus, l’okh considérait que la plus grande partie de la population civile française était porteuse de maladies vénériennes et les médecins militaires allemands étaient effectivement d’avis qu’occuper la France c’était mettre les pieds dans un territoire "infesté" par ces maladies.
Les officiers de santé développèrent, dans le cadre de l’instruction des troupes, une image effrayante des Françaises, image destinée à réveiller chez les hommes la peur de la femme castratrice et qui se concrétisa dans un mode de pensée hygiéniste.
La crainte de la Wehrmacht de voir l’armée allemande victorieuse vaincue par des rapports sexuels avec des Françaises atteintes des maladies vénériennes prit des proportions proprement fantasmatiques.
Ainsi, le bruit se répandit dans les milieux de l’administration militaire que la Résistance incitait délibérément des prostituées infectées à entretenir des relations avec des soldats allemands pour affaiblir les troupes d’occupation.
Le contrôle des relations sexuelles
Malgré tout, les stratégies préventives et eugénistes, radicalisées par le ressentiment anti-français, ne suffisent pas à expliquer à elles seules la décision de développer une gestion organisée des bordels.
Les motifs qui conduisirent le Haut Commandement de l’armée de terre à développer ce système dépassaient largement la volonté de réglementer la prostitution et d’empêcher les contacts entre soldats allemands et prostituées professionnelles en dehors des bordels.
Car le commandement militaire allemand s’efforçait d’infléchir l’ensemble de relations sexuelles entre soldats occupants et femmes françaises, et dans cette entreprise, la prévention des maladies vénériennes était certes un élément moteur mais sûrement pas le seul.
Il faut d’abord évoquer les considérations de politique raciale : les soldats allemands se virent interdire de fréquenter des "représentants de races étrangères", tandis que l’okh ordonnait la sélection raciale des pensionnaires de bordels.
Tandis que la réglementation à base raciale des relations sexuelles était exportée hors du Reich (les "lois de Nuremberg" de septembre 1935 rendaient passibles de poursuites
les relations sexuelles entre juifs et non-juifs),
l’administration militaire développait sur les relations avec les femmes françaises des directives plus larges qui répondaient plus spécifiquement à la situation d’occupation et au quotidien de l’occupation.
Son but était de dresser une barrière entre les soldats de la Wehrmacht et l’ensemble de la population française et elle martelait, dans d’innombrables notes de service destinées à la troupe, l’injonction de se tenir à distance de la population civile française.. De fait, il s’agissait bien des relations personnelles avec les Françaises. A chaque fois, le détail des mesures se référait explicitement aux contacts des occupants avec les Françaises.
Le nombre et la fréquence des instructions détaillées des autorités d’occupation, à propos de la fréquentation des Françaises, est à peine concevable aujourd’hui.
Les relations sexuelles des soldats allemands dans la France occupée étaient réglées dans le moindre détail par une quantité invraisemblable de dispositions.
La Wehrmacht interdisait ainsi à ses membres de donner le bras aux Françaises, de s’asseoir avec elles sur les bancs des jardins publics ou de fréquenter les cafés et les manifestations publiques.
De même, la troupe n’avait pas le droit de faire monter des Françaises dans des chambres d’hôtel ou des logements de la Wehrmacht, ou d’entretenir des relations de nature maritale dans la zone occupée.
L’exploitation systématique des documents relatifs à la question permet quelques suppositions sur les motifs liés à cette limitation des contacts.
Il s’agissait, sans aucun doute, de contribuer au maintien de la discipline militaire, c’est-à-dire d’éviter de donner l’impression que les soldats et officiers allemands stationnés en France et donc loin du front, pouvaient se consacrer à leurs plaisirs personnels ;
le contact incontrôlé avec des femmes était considéré comme le symbole par excellence. Les autorités d’occupation étaient également soucieuses, face à la société française, de faire preuve de maîtrise de soi et d’autodiscipline jusque sur le terrain sexuel et de ne pas compromettre par le comportement personnel quotidien le mythe développé par la propagande d’une Wehrmacht toute puissante.
En outre, l’administration militaire allemande attribuait une dimension nationale aux relations sexuelles en territoire occupé.
Du moment que la propagande mensongère énonçait que la France avait imposé la guerre à l’Allemagne et provoqué ainsi d’innombrables morts dans les rangs allemands, le contact intime des troupes avec les femmes de l’ennemi vaincu prenait aux yeux des occupants des allures de trahison de l’honneur national.

A la discipline, à l’image de la puissance occupante, à la proclamation de la France comme ennemi national s’ajoutèrent, au fil du temps et de plus en plus, des éléments de sécurité policière et de contre-espionnage.
Si les relations sexuelles en dehors des bordels avaient été initialement dénoncées comme une menace pour les forces allemandes (essentiellement pour des raisons d’hygiène épidémiologique), à partir de l’été 1941, les considérations militaires de sécurité et de contre-espionnage au sens large se développèrent.
Les autorités allemandes ayant cru pouvoir constater que les groupes de résistance attaquaient de préférence les soldats accompagnés de femmes, elles multiplièrent les interdictions de contacts avec les femmes françaises
Militärbefehlshaber in Frankreich, Kommando Stab IIa,....
Parallèlement, la surveillance des relations sexuelles prit une place importante dans les activités de contre-espionnage militaire, la Wehrmacht considérant que les contacts privés avec la population civile (particulièrement les femmes), pouvaient entraîner la divulgation d’informations militaires ou une influence politique sur des membres de la Wehrmacht.
Enfin, les autorités d’occupation savaient que, dans le cadre du "travail allemand", la résistance communiste envoyait délibérément des femmes françaises vers des soldats allemands pour jauger le moral des occupants grâce à ces contacts personnels, pour essayer de les démoraliser et d’établir des liaisons avec les rares soldats allemands critiques à l’égard de la conduite de guerre nazie.

Outre les considérations de politique sanitaire et raciale, divers facteurs directement liés à l’occupation vinrent donc peser de façon décisive sur le contrôle des relations sexuelles entre membres de la Wehrmacht et habitantes du territoire français. Les impératifs liés à la politique d’occupation conduisirent le contrôle de la prostitution par les Allemands bien au-delà de la régulation d’un marché du travail sexuel stricto sensu.
Dans la pratique, l’interdiction des contacts ne s’exerça que partiellement sur les soldats et les sanctions furent majoritairement prononcées non pas contre les hommes allemands, mais contre les Françaises. Si la Wehrmacht accorda dans les faits quelques marges de liberté à ses hommes, tenir les troupes d’occupation à l’écart de la population civile resta la ligne de conduite dans l’organisation du quotidien de l’occupation.

La volonté d’éviter toute relation personnelle entre occupants et habitantes du pays occupé était la première motivation directe de la mise en place du système des bordels. Les états-majors allemands concevaient la fréquentation des bordels comme une alternative aux relations privées entre sexes.
C’était donc souvent les mêmes notes de service, les mêmes instructions, qui invitaient à s’abstenir de contacts avec la population civile et qui fournissaient aux troupes les dernières informations sur le fonctionnement des bordels.
Les bordels comme méthode d’encadrement :
La participation des troupes aux fruits de la victoire
La volonté des autorités militaires allemandes de limiter les relations incontrôlées avec la population civile ne débouchait pas fatalement sur la mise en place d’un système organisé de bordels.
On aurait pu imposer aux soldats, par la menace de sanctions rigoureuses, l’abstinence sexuelle en territoire occupé.
De fait, un certain nombre d’officiers allemands, favorables à une telle orientation, restaient sceptiques quant à l’organisation de bordels militaires dans la France occupée.
L’okh rejeta cependant résolument les prises de position en ce sens okh, GenStdh., GenQu, Heeresarzt, Sammelverfügung Nr9,....
Car la création des bordels propres à la Wehrmacht ne devait pas seulement empêcher les relations incontrôlées de soldats avec les femmes. Elle reposait aussi sur la volonté du commandement allemand de donner à la troupe la possibilité de rencontrer des femmes et d’offrir des distractions sexuelles aux soldats allemands.
Le système de bordels de la Wehrmacht était en fait également un service offert par l’okh, en récompense de la participation loyale à la guerre de pillage et d’anéantissement qui déferlait sur l’ensemble du continent européen.
Considéré comme un élément de la conduite des troupes, il était le pendant aux exécutions de masse par lesquels les dirigeants militaires allemands réagissaient aux désertions.
Il montrait en effet aux soldats allemands, qu’en tant que membres de la Wehrmacht, ils bénéficiaient de satisfactions sexuelles et qu’on ne reculait devant aucun effort pour leur permettre de rencontrer des femmes françaises sans risque ni désagrément personnel, puisque la protection militaire et médicale était
assurée au même titre qu’une tarification homogène.
Réserver des bordels à la Wehrmacht signalait aussi aux soldats allemands qu’ils pouvaient participer à la victoire sur la France et que l’appartenance à la Wehrmacht était assortie d’avantages d’ordre privé.
La fréquentation du bordel était l’une des attractions que le séjour en France procurait aux soldats de rang inférieur.
La supériorité militaire allemande ouvrait les bordels français également aux membres des couches inférieures de la population allemande sous l’uniforme pour lesquels un voyage dans le pays voisin était impensable avant la guerre.
La surveillance des bordels et de la prostitution imposée en France en 1940 devint un modèle pour les services sanitaires de l’okh lorsque, ultérieurement, ils introduisirent, dans de vastes zones de l’Europe sous domination allemande, des mesures destinées à poursuivre les femmes soupçonnées de prostitution et qu’ils mirent en place des bordels réservés aux troupes allemandes.
En pratique, en dépit de la quasi-absence de recherches sur le sujet, il semble qu’on puisse affirmer qu’aucun autre pays ne fut couvert, comme la France, par un tel réseau de bordels.
En outre, ni le caractère de modèle du système mis en place dans la France occupée, ni la planification décidée à Berlin, n’empêchèrent l’existence de différences importantes dans l’action effective de la Wehrmacht dans les divers pays occupés.
Cela vaut en particulier pour la violence exercée contre les femmes.
En Europe de l’Est, où les occupants allemands traînaient jeunes filles et femmes dans leurs bordels en les menaçant de mort ; dans ces lieux, il s’agissait davantage de viols organisés dans une atmosphère de terreur, que de prostitution.
La surveillance de la prostitution par la Wehrmacht en France ne relève guère de l’histoire de la violence sexuelle contre les femmes pendant la guerre.
L’administration militaire ne pourchassait pas les Françaises pour les contraindre à se prostituer avec les membres de la Wehrmacht.
Au contraire, la répression la plus rigoureuse était dirigée contre les femmes des couches populaires qui fréquentaient des soldats allemands contre la volonté de la puissance occupante.
En persécutant les Françaises soupçonnées de prostitution et en mettant en place le système des bordels, les autorités allemandes cherchaient d’abord à déterminer quelles femmes seraient en contact avec leurs soldats et dans quelles conditions.
Leur objectif était de réglementer les relations sexuelles entre les troupes d’occupation et la population civile féminine.
Leur réglementation, fondée sur des mesures de contrainte et de répression contre les Françaises concernées, faisait des hommes allemands les profiteurs de la conduite de guerre et de l’occupation.