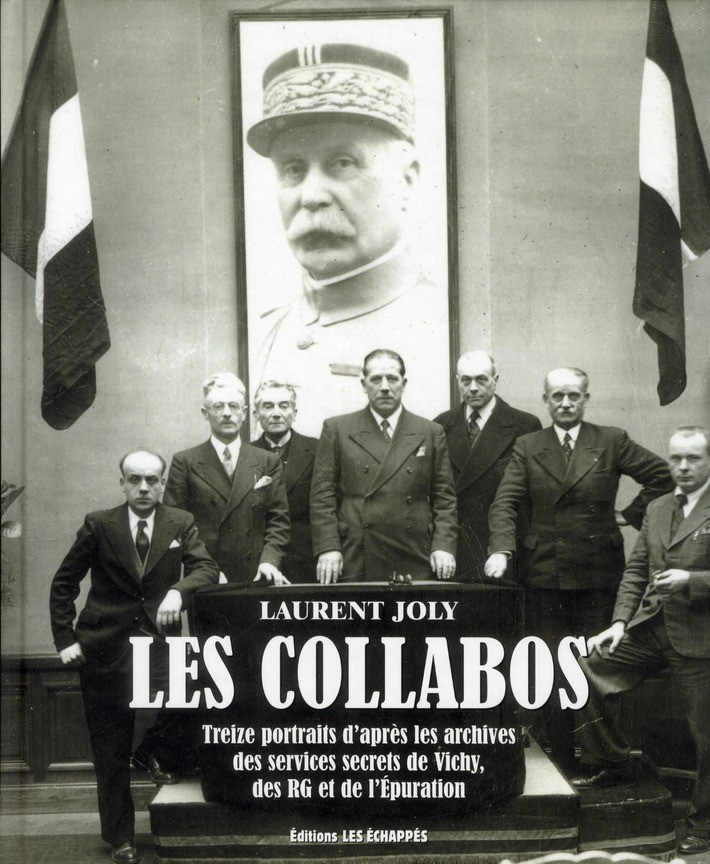Louis Renault jouait un rôle important au sein de ce haut patronat français qui misa durant les années 1930 sur l’extrême droite putschiste et ferait mieux de se faire oublier. Ci-dessous, quatre liens vers des articles que j’ai déjà mis en ligne sur ce sujet :
La CAGOULE, organisation fasciste française, tente un coup d’état pour renverser la République le 15 novembre 1937
Le patronat français, allié de la Cagoule, organisation fasciste et terroriste
Les 200 familles, le fascisme et la violence dans les années 1930
Du 6 au 12 février 1934, la France ouvrière et républicaine stoppe le fascisme
Hitler utilisa de 1933 à 1939 des camps de concentration ignobles pour éliminer des dizaines de milliers de militants de gauche, syndicalistes et juifs. Cela n’empêcha pas Louis Renault de rencontrer le führer amicalement et longuement en 1935 puis 1938 et 1939.
Face à ceux qui voulaient stopper Hitler assez tôt dans ces années 1930, Louis Renault prôna l’entente franco-allemande ; pire, pour un industriel spécialisé dans la production de tanks durant la 1ère guerre mondiale, il joua le pacifiste incompétent " les programmes de guerre ne correspondent pas aux possibilités de nos usines". Cela n’empêcha évidemment pas les usines Renault de se spécialiser dans la réparation des chars nazis durant la guerre.
Annie Lacroix Riz bénéficie justement d’une grande reconnaissance comme historienne sur ces questions concernant Louis Renault. Voici donc son point de vue détaillé, ci-dessous.
Jacques Serieys
Le 13 juillet 2010, la Cour d’Appel de Limoges, saisie par deux petits-enfants de Louis Renault (sur huit), Hélène Renault-Dingli et Louis Renault, a condamné le « Centre de la mémoire » d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) à payer 2.000 euros aux plaignants. Elle a également exigé que fût retirée de l’exposition permanente (depuis 1999) une photo de l’industriel, entouré d’Hitler et Göring, leur montrant une Juvaquatre au salon de l’auto de Berlin de [février] 1939, avec cette légende : « Louis Renault présente un prototype à Hitler et Göring à Berlin en 1938 (sic) [...] Louis Renault fabriqua des chars pour la Wehrmacht. Renault sera nationalisé à la Libération. » Définir Louis Renault « "comme l’incarnation de la collaboration industrielle" » au moyen « d’une photo anachronique » dont la légende lui impute une « inexacte activité de fabrication de chars » constituerait une « véritable dénaturation des faits [...D]ans un contexte de préparation du visiteur à la découverte brutale des atrocités commises le 10 juin 1944 par les nazis de la division Waffen SS das Reich, [ceci] ne peut manquer de créer un lien historiquement infondé entre le rôle de Louis Renault pendant l’Occupation et les cruautés dont furent victimes les habitants d’Oradour-sur-Glane" »[1]. Le Monde Magazine du 8 janvier 2011 se fait l’écho de cette thèse dans un dossier de 5 pages intitulé : « Renault. La justice révise les années noires ».
Ainsi se précise à l’occasion d’une initiative « familiale » la vaste entreprise de réhabilitation de Louis Renault, et avec lui, du haut patronat français sous l’Occupation, relancée depuis les années 1990 par plusieurs historiens et publicistes[2]. Dans la dernière de ces hagiographies (2009), Jean-Noël Mouret, qui « se partage entre la communication institutionnelle et les guides de voyage », a cloné une série caractérisée par le recours aux témoignages postérieurs à l’Occupation jamais confrontés aux sources originales contradictoires, par la négation du sens de celles-ci dans les rares cas où il en est fait usage et par la philippique contre un PCF qui aurait été assoiffé de vengeance contre le malheureux industriel depuis l’entre-deux-guerres, et enfin capable de l’assouvir à la Libération : cette pieuvre, étouffant l’appareil d’État dans ses tentacules, plaçant partout ses pions, harcelant et manipulant ses partenaires gouvernementaux, serait la responsable de l’injustice commise contre Louis Renault ‑ iniquité soulignant l’illégitimité de la nationalisation de ses usines[3]. Thomas Wieder, après avoir en une demi-colonne esquissé le « désaccord » séparant « les historiens » (travaux les plus critiques omis[4]), accrédite la thèse « familiale » en interviewant longuement « Laurent Dingli, historien », mari d’un(e) des deux plaignants, auteur d’un Louis Renault (2000) auprès duquel l’hagiographie d’Emmanuel Chadeau (1998) fait figure d’ouvrage critique[5]. Selon ce petit-fils par alliance de Renault, docteur en histoire d’ordinaire voué au roman historique « moderne » (Colbert en 1997, Robespierre en 2008), « jamais Louis Renault n’a accepté de fabriquer ni de réparer des chars pour les Allemands »[6].
Le Renault d’avant-guerre
La Cour d’Appel de Limoges reproche au « Centre » d’Oradour d’avoir donné à une photo d’avant-guerre une légende portant en partie sur l’Occupation ou d’avoir choisi pour traiter de l’Occupation un document antérieur à cette période. En dépit de la pertinence de ce grief formel, le texte présentant le Louis Renault de l’Occupation comme conforme à celui de l’avant-guerre est historiquement fondé. La collaboration politique et économique de 1940 à 1944 poursuivit celle que Louis Renault, comme tout le grand patronat, avait nouée avec le Reich pré-hitlérien et hitlérien. C’est la volonté de la maintenir à tout prix, et en tous domaines, qui généra la défaite et toutes ses conséquences pour les ouvriers des usines Renault, pour le peuple français et pour d’autres : Blitzkrieg achevé avec la Débâcle française, Renault influa, comme tous ses pairs, sur la guerre à l’Est.
Avant le 10 mai 1940, Renault livra la guerre au seul ennemi intérieur, la conduisit avec acharnement contre ses propres ouvriers et opta pour la politique des bras croisés envers l’ennemi extérieur - le Reich et l’Axe Rome-Berlin. Il prépara, comme ses pairs, un plan de liquidation du régime républicain en finançant les ligues fascistes (parmi lesquelles les Croix de Feu du colonel de la Rocque) puis la Cagoule qui unit les factieux depuis 1935-1936. Il mit son veto à tout effort de guerre et prôna l’« entente » franco-allemande entre gens de bonne volonté, Hitler en tête. Il afficha un pacifisme antagonique avec son fort rentable allant « patriotique » de la Première Guerre mondiale et clama qu’on ne pouvait plus gagner d’argent qu’en fabriquant des véhicules de tourisme[7] : « les programmes de guerre ne correspondaient pas aux possibilités de nos usines et [...] les changements fréquents de ces programmes ne permettent pas de faire un travail sérieux », écrivit-il au président du Conseil (Daladier), le 8 novembre 1939[8]. Il s’entretint deux heures avec Hitler le 21 février 1935 à la Chancellerie du Reich[9], en 1938 et en février 1939 (objet de la photo), dernière rencontre suivie de l’adoption d’une formule assez connue de son personnel pour devenir son surnom, « Hitler-m’a-dit »[10]. Il aimait autant Mussolini et son « familier, [Giovanni] Agnelli », qui vint à Paris en décembre 1939, en pleine drôle de guerre, alors que l’Italie fasciste avait conclu le 22 mai une alliance offensive avec le Reich (le « pacte d’acier ») : le patron de la FIAT comptait « revenir au début de 1940 à la tête d’une délégation d’industriels italiens, pour jeter les bases d’une collaboration économique entre la France et l’Italie. »[11]. Les événements militaires et politiques se déroulant comme prévu, l’œuvre s’accomplit avec à peine un an de retard.
Louis Renault avait délégué aux missions politiques intérieures et extérieures qui firent triompher les putschistes de l’été 1940 sa garde rapprochée, que je borne ici à trois éminences de Vichy :
- le baron Petiet, chef de ses aciéries (UCPMI), trésorier de la CGPF (Confédération générale de la Production française dite, depuis juillet 1936, du Patronat français, ancêtre du MEDEF), organisateur de l’émeute fasciste du 6 février 1934et bailleur de fonds de la Cagoule au nom du Comité des Forges (alors dirigé par François de Wendel) ;
- René de Peyrecave de Lamarque, autre cagoulard avéré, « administrateur-directeur » depuis 1934 de la société anonyme des usines Renault (SAUR), après avoir présidé la Société d’importation de charbon et autres produits (SICAP) créée pour traiter avec l’Office du charbon allemand (Kohlensyndicat ou KS) ;
- François Lehideux, neveu par alliance de Renault, administrateur directeur de la SAUR dès 1930, administrateur-délégué en 1934, particulièrement chargé de la lutte des classes dans ce fief du communisme parisien et de la CGT (syndicat ici issu de l’ex-Confédération générale du Travail unitaire, CGTU). Lehideux, financier de la Cagoule au nom de Renault, était aussi un des chefs de la synarchie, club de grands banquiers et industriels qui avaient dès 1934 chargé Pétain et Laval d’abattre la République, et dont les délégués envahirent « l’État français » : ils occupèrent tous ses postes économiques, sans négliger l’intérieur grâce auquel Pierre Pucheu, de juillet 1941 à avril 1942, fit grandement avancer « l’extermination des cadres du mouvement ouvrier » tandis que son ami Lehideux lui succédait à la production industrielle[12]. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1938, Lehideux avait en personne supervisé, aux côtés du préfet de police Roger Langeron - qui accueillit l’occupant allemand au moins aussi bien que la maison Renault[13]‑ la répression militaire baptisée « évacuation » des grévistes de Renault-Billancourt accusés de « rébellion »[14].
Cette guerre contre les « unitaires » des Métaux seconda l’invasion, comme l’écrivirent les services économiques attachés au commandant militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF), dirigés par le Dr Elmar Michel (section Wi), dans un de leurs nombreux portraits flatteurs de Lehideux (L.) : « pendant la guerre et aussi déjà depuis 1938 une propagande germanophile avait été conduite dans les syndicats ouvriers [traduction : jaunes] fondés par L. (sic) et surtout parmi les travailleurs des usines Renault »[15]. Est-ce contre les ordres de Louis Renault que sa garde rapprochée combattit avant l’Occupation ses ouvriers, la République et le réarmement ? Le Monde esquive son rôle avant juillet 1940, préférant consacrer une page entière... au colonel de La Rocque dont « la famille refuse qu’il soit qualifié de fasciste » : à bon droit, estime Wieder, puisque cinq prestigieuses « signatures » d’historiens ont « épaissi [...] le dossier de la défense ». La correspondance originale, française et allemande, ôte tout doute sur le fascisme stricto sensu du chef des Croix de Feu, par ailleurs grand favori de Louis Renault, Lehideux, etc., jusqu’à l’ère Doriot (1936-1937)[16], mais le présent contentieux m’oblige à revenir à son seul grand bailleur de fonds. La campagne de réhabilitation de l’oncle l’opposant au neveu, je m’arrêterai sur ce point avant d’aborder l’objet qui définit ou exclut la « collaboration » selon l’arrêt de Limoges : « la fabrication des chars pour la Wehrmacht ».
Le Renault de l’Occupation
Le Renault de l’Occupation ne démentit pas celui de l’avant-guerre, et son neveu, comme le reste de sa garde rapprochée, l’aida à assurer la continuité. Lehideux est certes honni des héritiers de Louis Renault, qui le jurent seul responsable, dès juillet-août 1940, de la collaboration économique avec l’occupant ou de la « réparation [forcée] des chars » sur « réquisition ». Non seulement Renault ne chassa pas de sa société son neveu, mais Vichy promut ce dernier comme tous les auxiliaires de haut rang de l’industriel. Le 1er octobre 1940, Lehideux fut nommé « directeur responsable du comité d’organisation de l’industrie automobile » (COA) constitué le 30 septembre, et Petiet « chef du comité d’organisation du cycle » et « président de la chambre consultative du COA. ». En dépit de la prétendue brouille irréparable entre l’oncle et le neveu depuis l’été, Lehideux resta sous l’Occupation, comme Peyrecave, membre du « conseil d’administration » de la SAUR dont « Renault », son président, continuait à détenir « une très grosse part majoritaire ». La liste des administrateurs de juin 1942 est formelle : Marcel Champin, Paul Hugé, Samuel Guillelmon, Roger Boullaire, François Lehideux, Pierre Rochefort, Charles Serge, René de Peyrecave de Lamarque[17].
Doté de fonctions étatiques (été 1940-avril 1942, dont le secrétariat d’État-ministère de la production industrielle (PI) de juillet 1941 à avril 1942), ou non, Lehideux dirigea, jusqu’à son arrestation, le 28 août 1944, le COA. C’est à dire un organisme créé comme tous les comités d’organisation sur le modèle allemand des Reichsgruppen et sous l’œil vigilant de l’occupant, en vertu du décret général du 16 août 1940. Ce décret, œuvre du grand synarque Jacques Barnaud, chef de cabinet (mais vrai ministre) du ministre cosmétique de la PI, l’ex-secrétaire général adjoint de la CGT René Belin, fut le pilier du dispositif économique, intérieur et extérieur, créé par la synarchie après la Défaite et grâce à celle-ci. Complété par l’Office central de répartition des produits industriels (OCRPI), créé par décret (du même Barnaud) du 10 septembre 1940, il permit une concentration intérieure de l’économie qui, à court terme, visait à drainer la quasi-totalité des matières premières et des produits finis français vers le Reich[18].
Quant à Peyrecave, « directeur des usines Renault », puis son « directeur général par délégation, administrateur de sociétés » nombreuses, dont Air-France, et « président de la Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d’avions », il fut à l’été 1940 nommé à la commission d’armistice auprès du général Huntziger - personnage-clé de la trahison militaire ‑ et affecté aux commandes allemandes à l’industrie française[19]. C’est sa qualité de « président du conseil d’administration » du « Groupe Caudron-Renault » qui lui valut, en septembre 1944, sa place sur la liste des huit personnalités (parmi lesquelles Louis Renault) dont le ministère de l’Air requérait l’arrestation[20]. Renault haïssait-il également Peyrecave ?
Lehideux, artisan du cartel automobile « européen » contre Louis Renault ?
La réorganisation à l’allemande de l’économie française (CO et OCRPI) s’opéra dans l’automobile comme ailleurs sur fond de bonnes manières mutuelles. Renault s’y tailla la part du lion, accueillant à Paris dans les jours suivant la nomination de Lehideux à la tête du COA, l’industriel allemand Karl Schippert, directeur général des usines Mercedes-Benz à Stuttgart : il « vient d’être chargé par le gouvernement du Reich de la réorganisation en France occupée de l’industrie automobile [et...] s’est installé à cet effet, avec plusieurs techniciens, aux usines Renault », releva la Sûreté nationale le 4 octobre 1940, sans signaler l’invasion ou le viol de la maison par cette prestigieuse cohorte. Schippert « déclare vouloir réorganiser l’industrie automobile en France en trois branches : 1° camions de transport : Renault-Saurer-Latil-Unic ; 2° voitures de tourisme : Renault-Citroën-Peugeot ; 3° voitures de luxe : Delage-Delahaye-Hispano-Suiza. »[21] Renault serait donc la seule firme à être représentée dans deux branches sur trois, à la veille de la formation du « comité européen de l’automobile » ‑ cartel sous direction allemande -, formule que Renault prônait publiquement depuis 1934 au moins.
Lehideux, administrateur de Renault, aurait-il donc mis en œuvre les vieux plans d’« entente européenne » du Patron contre le gré de ce dernier, en rencontrant à Berlin le 10 novembre 1940 le général Adolf von Schell ? Ce spécialiste allemand de la motorisation de l’armée depuis 1927 était sous Hitler sous-secrétaire d’État aux communications et « plénipotentiaire chargé de l’automobile » (Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen, GBK) depuis le 15 novembre 1938 : c’est à dire, avait alors exposé l’attaché militaire français à Berlin, « chef d’état-major chargé de l’inspection des troupes blindées [...et,] dans le cadre du plan de quatre ans [dirigé par Goering], de prendre des mesures dictatoriales tendant à faire faire à l’industrie allemande automobile le dernier pas décisif dans la voie de la mobilisation permanente », par rationalisation-concentration drastique (fabrication de 3 types de camions, au lieu de 130, via la création « un établissement d’expériences, commun à toutes les entreprises privées »[22]. En novembre 1940 Lehideux et von Schell planifièrent donc « la coopération européenne » : ils définirent un cartel franco-allemand-italien en « cinq points », dont un « programme [de fabrication] pour les types de véhicule » par pays et pour « l’ensemble européen » (article 1er), une « organisation du marché » intérieur (article 4) et une « réglementation de l’exportation » (article (5). Le texte était si largement connu dans les milieux automobiles que même le « mémoire de défense » de Lehideux de 1945 sur ledit « comité européen » ne put l’esquiver[23].
Est-ce contre Renault que, le 24 décembre 1940, un Lehideux lyrique, « retour d’Allemagne », « présent[a] » à la presse sous tutelle allemande « son rapport de collaboration, [...] plan qui correspond[ait] aux exigences des temps présents »[24] ? Le chef du COA venait de « demande[r] à ses collaborateurs Champomier et [André] Reynaud », respectivement directeur général du COA et chef de cette délégation française à Berlin, « d’établir les bases du comité de collaboration internationale. [Son plan] prévoyait que seraient réunis à la France outre le marché métropolitain, la Hollande, la Belgique, la Suisse et l’Espagne. Il déterminait les zones propres à l’Allemagne et à l’Italie et terminait en énonçant : "aucune voiture américaine" »[25]. C’est précisément la formule que Louis Renault avait vantée à Hitler le 21 février 1935 : « Une guerre économique entre la France et l’Allemagne n’aurait d’avantages que pour l’Angleterre et l’Amérique »[26]. L’exclusion de la terrible concurrence américaine faisait depuis la crise l’unanimité au sein du patronat synarchique naguère plus tourné vers la Manche et l’Atlantique[27].
Est-ce contre Renault que Lehideux, toujours accompagné de ses hommes de confiance, mit en œuvre le cartel tripartite via « deux [...] accords » officiels ? Le premier, créant « une commission [que Lehideux décréta en 1945] transitoire pour la collaboration de l’industrie automobile européenne », fut signé « à Berlin du 1er au 6 mars 1941 » aux « entretiens au GBK », par von Schell et Egger, Lehideux, chef du COA (incluant Renault), et Giuseppe Acutis, président de l’association nationale de l’industrie automobile (ANFIA) étroitement lié à Giovanni Agnelli. Ces engagements, respectivement souscrits au nom du Reich, de la France et de l’Italie, furent consignés dans au moins trois rapports, un allemand et deux français. Le second accord, signé le 8 juillet 1942 par Egger, Lehideux et Acutis, « fix[a...] la contribution annuelle » de chaque membre du cartel (aucunement transitoire) « à 8 000 marks ». Entre temps, Lehideux - toujours contre Renault ? - avait fait la navette pour le cartel « européen », surtout en terre allemande, en 1941, fin février-début mars, fin mars, fin avril, fin septembre-début octobre à Berlin, en novembre à Turin ; en 1942 à Nuremberg (en avril-mai) et à Stuttgart (en novembre), etc.[28] ‑ sans préjudice de maint autre voyage. Les conditions de la création, précoce (un des records chronologiques de la cartellisation allemande générale de l’industrie de la France occupée) [29], d’un cartel dominé par l’appareil du plan (de guerre) de quatre ans excluent l’atmosphère de siège et de « réquisition » décrite par Lehideux et son entourage au cours de l’instruction des procès d’après-Libération ‑ instruction à laquelle Renault fut naturellement soustrait par son décès d’octobre 1944 à la prison de Fresnes.
Entre Paris et l’Allemagne, Lehideux et son état-major du COA ou/et de la SAUR ne préparèrent pas seulement le cartel qui régirait l’automobile dans l’Europe d’après victoire allemande : ils discutèrent avant tout des commandes militaires allemandes à l’industrie automobile en général et à Renault en particulier.
Renault et les « chars pour les Allemands »
Ces commandes allemandes, fruit exclusif de « réquisitions », n’auraient, en dépit de telles réquisitions, pas inclus de chars : « aucun travail historique, tranche la cour d’appel de Limoges, n’infirme une décision judiciaire du 30 avril 1949 disant que les usines Renault n’avaient pas fabriqué de chars ou de chenillettes mais avaient été obligées d’effectuer des réparations durant la guerre. »
La réparation des chars pour la Wehrmacht, acquise le 1er août 1940
En juillet-août 1940, l’oncle devança même le neveu, qui, appuyé après la Libération par une légion de « témoins » ‑ presque tous aussi impliqués que lui dans la collaboration économique et étatique ‑, mua leur divergence tactique, fugace, en preuve (démentie par toute la correspondance d’Occupation) de sa « résistance » à Louis Renault.
Ce dernier, revenu début juillet des États-Unis, discuta avec les Allemands pendant « trois semaines [...] sur la question de la réparation des chars ». Le 1er août, il signifia au général Tuckertort son acceptation formelle, étayée par une lettre « remise à la fin de [cette] conférence », de réparer pour la Wehrmacht « dès le 2 août » les chars de la maison. La réunion du dimanche 4 août à l’Hôtel Majestic, entre six Allemands, dont Tuckertort et le ministre Schmidt, chef de la division économique de l’administration militaire en France (MBF), et le trio Lehideux, Petiet, Grandjean, permit de faire le point. Elle eut lieu en l’absence de Renault qui avait, le 2 août, sollicité de la partie allemande « un délai de 10 jours » de réflexion. Celle-ci le déplora mais rappela que, cette « condition [...] acceptée, Renault prenait l’engagement de commencer les travaux de réparation de chars dès le 2 août ». « Renault, ajouta-t-elle, lui a remis une lettre destinée au général et a confirmé verbalement et à plusieurs reprises ce qu’il avait écrit, à savoir [que] Lehideux avait pleins pouvoirs pour traiter de la question de l’entretien des chars. Il a donné l’assurance qu’il n’aurait pas à désavouer Lehideux. »
L’échange Schmidt-Petiet-Lehideux, dans le cadre de « la discussion [...] ouverte [...] depuis trois semaines » (Schmidt), balaie les variations que la décision de « réparation des chars » de l’été 1940 inspira post Liberationem à Lehideux et consorts. Il suggère que l’entourage de Renault, 1° avait obtenu de prolonger les tractations que son empressement avait arrêtées le 1er août et, 2° avait préféré continuer, le 4, « la discussion » sans lui. Ce procès-verbal du 4 août 1940 fait litière de la thèse, empruntée aux mémoires de Lehideux par Mouret, soit de la surprise du neveu devant la décision unilatérale de son oncle brutalement signifiée par les Allemands, soit d’un « bluff » allemand resté sans trace écrite[30]. Il confirme l’existence de l’accord du 1er signé par Renault, qui fut définitivement acquis au prix, seule nouveauté du jour, d’une précaution tactique que, dans sa hâte, le Patron avait omise.
À la question posée par Schmidt à ses interlocuteurs français : « Pourquoi ne voulez-vous pas faire les travaux demandés par le général ? », Petiet, se posant, non en seul représentant de Renault, mais en délégué général de l’industrie automobile (le décret de l’ami Barnaud instituant les comités d’organisation était imminent), répondit ainsi : il « rappelle ses entretiens avec le colonel Thoenissen » ‑ adjoint du général von Schell et chef du GBK en France - « et le major Hoezhauer qui ont demandé d’étudier le problème de la collaboration des usines d’automobiles françaises avec l’industrie allemande. Ces conversations doivent reprendre dans les prochains jours et il a été désigné pour représenter l’industrie française, c’est la raison pour laquelle il a demandé à être reçu en même temps que les représentants des usines Renault. »
Lehideux prit la suite de Petiet, arguant que son oncle était « tout juste [revenu] aux usines quand il a[vait] eu les premières discussions avec le commissaire allemand et qu’il n’avait pas eu le temps de se mettre au courant des directives de son gouvernement, ni de se rendre compte exactement des sentiments de ses collaborateurs, directeurs, ingénieurs et maîtrise, dont certains venaient de combattre dans des chars Renault. Après ses entretiens du 1er août, Renault a dû se rendre compte qu’il ne pouvait pas demander à ces collaborateurs d’effectuer les travaux qui lui étaient demandés. [...C]e n’est pas au moment précis où l’on demande à l’industrie automobile et aux usines Renault de s’engager dans la voie de la collaboration avec l’industrie allemande que l’on peut demander aux cadres de l’usine d’effectuer les travaux qui apparaissent comme les plus pénibles pour leur sentiment national.
[ Lehideux] fait part de la décision déjà prise de fournir les pièces de rechange de la fabrication Renault qui seraient utiles pour la réparation des chars, de donner tous renseignements utiles sur les pièces fabriquées au dehors, de faciliter le recrutement de la main-d’œuvre. Mais il demande avec insistance que la direction des travaux de réparations soit assurée par les autorités allemandes.
le ministre Schmidt prend acte de la déclaration de Lehideux, qu’il résume comme suit :
1° Les cadres des usines Renault refusent d’exécuter les instructions données par Renault pour la réparation des chars.
2° Les usines n’ont pas demandé aux ouvriers s’ils seraient d’accord pour effectuer ces travaux.
3° Il y a opposition entre Renault et la direction des usines sur cette question.
Lehideux répond que ses déclarations ne peuvent se traduire en formules aussi absolues. La réticence des cadres s’est manifestée sous une forme plus nuancée. Aucune question ne leur fut d’ailleurs posée. Lehideux estimait de son devoir de traduire ce qu’il savait être le sentiment profond qui animait ses cadres. Lehideux rappelle comment il envisage la collaboration des usines pour faciliter le travail de la direction allemande qui serait chargée de la réparation et, sur la demande du ministre, donne sa parole qu’il donnera l’aide utile.
Avant de lever la séance, s’établit une conversation entre les membres allemands » et l’un d’entre eux « déclare qu’il peut prendre en charge la réparation des chars sous les conditions de collaboration indiquées par Lehideux. La séance est levée sur l’impression très précise que la solution est admise. »[31]
Il ressort du compte rendu écrit de cet entretien qu’entre les 1er et 4 août 1940, Louis Renault et la direction de la SAUR agréèrent définitivement l’exigence allemande de réparation des chars français pour usage allemand ; et que Lehideux, le 4 août, requit de Schmidt, en leur nom, « la direction allemande » de ces travaux, seule apte à soustraire la direction française à ses responsabilités face à un personnel très réticent. Ainsi naquit la « réquisition » allemande, née d’une demande française, astuce juridique si utile après la Libération dont usèrent pour des raisons comptables les hauts fonctionnaires réunis après les bombardements anglais de mars 1942 dans le bureau de Barnaud (depuis mars 1941 délégué général aux relations économiques franco-allemandes) : « La Wehrmacht a réquisitionné un atelier chez Renault pour la réparation de chars effectuée par la maison allemande Daimler-Benz. »[32]
« La fabrication des chars » avant le 22 juin 1941
La hâte à s’exécuter fut générale, et typique des inclinations « arbeitswillig » (de bonne volonté au travail) des milieux économiques français relevées par l’occupant[33]. En témoigne le contenu des réunions tenues depuis l’automne 1940 par le GBK et le COA, hommes de Renault, Lehideux et André Reynaud, en tête. Le MBF ne cessa de se féliciter dès le début de 1941 (et jusqu’au terme de l’Occupation) du succès des « négociations avec l’industrie allemande début janvier » : elles avaient abouti au « plan automobile conclu par Lehideux avec le général von Schell et [à] l’important transfert des commandes pour lequel les capacités de l’industrie française ont été dans une large mesure mises à la disposition de l’économie allemande, y compris pour la pure et simple production de guerre »[34]. Peyrecave, apprécié des hagiographes de Renault, s’afficha donc « à Vichy » dans la seconde quinzaine de janvier 1941 pour discuter « des accords franco-allemands de la métallurgie. »[35]
Sans attendre la signature du plan Lehideux-von Schell, Renault s’était inscrit au firmament d’une galaxie automobile entièrement mobilisée au service de l’économie de guerre allemande. L’effort fut spectaculaire avant que le Reich n’eût mené à bien son vieux projet de conquête de la Russie, qu’il s’agît de chars (ou tanks) ou du reste. On ne s’activait pas seulement dans l’« installation » allemande directement gérée par la Wehrmacht chez Renault, mais dans l’ensemble des ateliers, ici et ailleurs. On ne travaillait pas seulement en zone occupée, supposée après la Libération avoir fonctionné, contre l’Angleterre, sur la base des strictes obligations de la convention d’Armistice du 22 juin 1940, via la « réquisition ». Depuis l’automne 1940 furent conclus des accords libres et privés stipulant « transfert de poids lourds de zone non occupée » - zone exclue de la convention d’Armistice et des contraintes allemandes y afférentes - « en zone occupée et en Alsace-Lorraine », accords qu’agréa officiellement le MBF à la mi-janvier 1941 : cette signature allemande concernait six sociétés automobiles, « Renault, 8, rue Émile Zola, Boulogne-Billancourt », ainsi que, à Paris, Delahaye, 20, rue du Banquier ; Citroën, 143, quai de Javel, Peugeot, 108, quai de Passy ; en banlieue, Latil, 8, rue Gallieni, Suresnes, et Matford, 225, quai Aulagnier, Asnières[36]. Au printemps 1941, on fabriquait couramment « en zone libre [...des] pièces de chars pour les autorités allemandes. »[37] L’Axe fut aussi gâté dans les colonies et protectorats non visés par les clauses de l’armistice : « connues dans le public », les livraisons massives aux Allemands et aux Italiens, de camions « en excellent état » mis à leur disposition par les Français à la frontière tripolitaine, les « réservoirs d’essence pleins et complètement chargés de vivres, notamment de légumes verts », soulevèrent alors « des sentiments d’indignation et de haine dans la population »[38].
Dans les mois précédant l’assaut allemand contre l’URSS, les usines s’étaient transformées en fourmilières, décrites par le menu aux services de renseignements gaullistes de Londres par une foule d’informateurs français (communistes ?), qui requéraient toujours des bombardements industriels susceptibles de paralyser l’appareil de guerre allemand. Ces courriers fixaient depuis la fin de l’hiver la date de l’attaque, « les commandes devant être prêtes pour le 15 juin » 1941. En mars, « Renault ‑ voitures de tourisme, camions, tanks ‑ », fut recensé en tête d’une liste d’entreprises « travaillant pour les Allemands », qui ne varierait guère jusqu’à la Libération de Paris : « Citroën [propriété de Michelin depuis 1935] ‑ voitures de tourisme, camions, tanks ; Latil, camions ; Saurer, chenillettes et camions ; les chenillettes sont tôlées comme des voitures ordinaires et non blindées, la caisse arrière est en bois ; Somua, à Saint-Ouen, tanks ; Hispano Suiza à Colombes, moteurs d’avions ; Gnome et Rhône à Paris et Gentilly, moteurs d’avions ; Ford entre Poissy et Asnières, camions, et toutes les maisons d’accessoires pour avions, Bronzavia, Air Équipement, Salmon, Isoflex, etc. »[39] Selon une note appelant aux bombardements alliés, intitulée « Industrie de guerre », aussi antagonique avec les arrêtés de cours de justice de 2010 ou de 1949 que la masse environnante des fiches d’avril-mai 1941, « 4-4-41 (sic)
les Établissements Renault à Billancourt travaillent jour et nuit pour les Allemands, fabriquant des automobiles et du matériel blindé. Une seule bombe lancée sur la centrale électrique située au Nord des fabriques suffirait à faire arrêter les travaux ; sans causer de pertes parmi les Français. Les Établissements Renault à Billancourt produisent actuellement une série de petits tanks Renault, qui sont livrés aux Allemands de la façon suivante : sous le contrôle d’un officier allemand, des ingénieurs français conduisent les tanks et effectuent deux ou trois tours sur la place en face du Pont de Sèvres. Lorsqu’il est évident qu’il ne peut y avoir aucun sabotage, des soldats allemands prennent les tanks des mains mêmes de nos ingénieurs.
7-4-41
Les Établissements Renault ne fabriquent soi-disant pas de bombes incendiaires pour les Allemands, mais leur fournissent des milliers de pot d’échappement de voitures en tôle que les Allemands remplissent de phosgène avec une fraction de mélinite et obtiennent de cette façon très simple une quantité de bombes incendiaires. »[40] Fin avril, un ouvrier de Billancourt « doit faire pour le 15 juin 420 pièces de tanks Renault. Ses camarades ont d’autres pièces à faire, mais le même nombre. Travail en série et à la chaîne de manière à avoir environ 420 tanks pour le 15 juin. Les Allemands sont très contents du tank Renault »[41].
Renault partageait alors avec « l’Usine Rateau, rue Carnot, au Pré St Gervais » la « transform[ation] en tanks allemands des anciens tanks français. [...] Les canons de 47 viennent, non finis, de Tchécoslovaquie, après être passés par l’atelier de la Courneuve, ils sont dirigés par voiture sur l’usine Renault. Il est sorti 60 canons dans le mois (avril). L’usine a encore une commande de 600. Il s’agit de canons anti-chars. »[42] Renault répartissait ses efforts, comme tous ses confrères, entre l’armement automobile et aéronautique : les usines Avia, qui « ont reçu [des] liasses [de] dessins [de] moteur Argus de combat H-110 » commencent la fabrication de « 10 [pièces] par jour aux usines FF » ; le montage s’en fait « aux usines Q 11 (entre place Nationale et Salmson) Billancourt » ; un « ingénieur allemand », Deken, « réceptionne » le tout. « À Issy-les-Moulineaux Caudron [Renault], on commence la fabrication des ailerons Messer[schmitt] »[43]). Les deux usines Renault du Pont de Sèvres font « l’une des avions Messerschmitt [,...] l’autre des tanks »[44].
Avant le 22 juin 1941, la production de tanks ou pièces de tanks n’avait donc pas été cantonnée à l’« installation réquisitionnée » de Renault-Billancourt sous gestion directe la Wehrmacht[45].
Renault et la frénésie franco-allemande à l’heure du front de l’Est
La guerre en Russie porta aux cimes la « collaboration de l’industrie automobile française aux programmes de guerre allemands » qui absorbaient depuis l’automne 1940 la quasi-totalité de ses activités. Le prétendu « secteur civil » approvisionnait d’ailleurs autant la Wehrmacht : au printemps 1941, « une impression fâcheuse [était] créée dans la population parisienne par le défilé journalier dans les artères principales de la capitale de voitures Peugeot, Renault et Citroën conduites par des soldats allemands. Ne serait-il pas possible d’envisager la circulation de ces voitures à des heures matinales et par des circuits moins centraux ? », demanda un collaborateur de Barnaud au chef du COA Lehideux fin mai[46]. Malgré les aléas des bombardements anglo-saxons ‑ tels ceux des 4 mars 1942, 4 avril et surtout 3 et 15 septembre 1943 de Renault-Billancourt, qui occasionnèrent de « gros dégâts »[47] ‑, des sabotages ouvriers et des effets du STO, les activités souffrirent peu. Stimulé par la direction et la Wehrmacht également frénétiques, le déblaiement « des usines Renault » de Boulogne-Billancourt fut après la nuit des 3-4 mars 1942 effectué en trois semaines par « les ouvriers et un grand nombre de soldats allemands »[48].
Précisons pour mémoire, ce champ dépassant celui des tanks, que, malgré sa fébrilité reconstructrice, la maison ne résista pas plus que les autres au recrutement allemand de main-d’œuvre forcée, et bien avant le décret de février 1943 sur le STO. Lehideux, comme chef du COA, transmit immédiatement la circulaire Laval du 2 juillet 1942 prônant la « relève » et la propagande en sa faveur, accompagnée de celle de son ami et successeur (depuis avril) au ministère de la PI, Jean Bichelonne, « donnant des instructions à ce sujet ». Il recommença en adressant « à ses ressortissants la circulaire [Bichelonne] du 31 décembre 1942 relative à la fourniture d’un contingent d’ouvriers spécialisés (57 000) destinés à travailler en Allemagne » : « avec la mention : "Nous vous demandons d’examiner très attentivement ce document, afin de suivre exactement les directives qu’il vous apporte". »[49] La direction de Renault fut aussi zélée - était-ce aussi contre l’avis Louis Renault ? ‑, et son entrain reflété par ces chiffres de novembre 1942 : à Billancourt « sur 200 désignés (...) 18 manquants, qui se sont d’ailleurs empressés de disparaître, soit 9% seulement de refus »[50].
La reconstruction prioritaire et la décentralisation des usines, de la région parisienne au Mans, firent merveille jusqu’au bout. Au premier semestre 1944, les usines du « Groupe Caudron-Renault », que présidait Peyrecave [51], fabriquaient des roulements à billes pour Messerschmitt et des avions Messerschmitt stricto sensu, « travaill[ai]ent jour et nuit » et leurs ouvriers « 54 h par semaine »[52]. On était alors souvent passé à l’étape de « la construction des usines souterraines ». La masse des fiches contemporaines avère les révélations du chef SS Knochen à la direction des RG en janvier 1947 : cette « construction [...] s’est poursuivie sans discontinuer et surtout sans tenir compte de la situation militaire qui évoluait défavorablement. C’est ainsi que malgré le repli de la Wehrmacht aussi bien en Russie, en Italie qu’en Afrique, et même après le débarquement allié en France, les travaux se sont poursuivis comme si de rien n’était. Au moment où il a fallu quitter le sol français, ces usines étaient prêtes à fonctionner »[53].
Jusqu’en juillet 1944 inclus, Renault se dressa à l’avant-garde de toute la région parisienne industrielle qui avait dans les mois précédents fonctionné en partie sous terre. Début juillet, les services allemands de Paris discutaient encore avec « des représentants d’Unic, Latil, Renault, Hotchkiss, » etc., du « plan général des carrières aménagées à Carrières-sous-Bois (entre Maisons-Laffitte et Saint-Germain) où d[evai]ent être installées les différentes usines souterraines » pour les « fabrications spéciales des usines suivantes : Renault (vilebrequins, roulements à billes) », ouvrait la liste. Tout était fin prêt, ateliers, voirie, approvisionnement en eau « par une centrale commune », en gaz, électricité, téléphone, « cantines communes » groupant « plusieurs usines », « garage commun » pour vélos, etc. « Dans cette question d’usine souterraine, Renault semble vouloir marcher seule et est actuellement plus avancée que les autres constructeurs. »[54] Toujours contre Renault, Lehideux, Peyrecave, etc.?
Le contribuable français dut assumer le coût des bombardements industriels britanniques, puis anglo-saxons. Ce nouveau fardeau s’ajouta à la gigantesque contribution des frais d’occupation et du clearing, née avec l’Occupation, qui faisait de la France la meilleure vache à lait du Reich en guerre (45% de la dette allemande de clearing totale)[55]. Le « 28 février 1942 » ‑ juste avant des bombardements attendus ‑ fut conclu « l’échange de notes franco-allemand » qui conférait aux entreprises privées et à l’occupant le droit d’exiger du « gouvernement français [...] la reconstruction et le financement des entreprises industrielles endommagées par des bombardements anglais »[56]. « Nous nous sommes » ainsi, expliqua peu après (le 19 mars) dans le bureau de Barnaud Maurice Couve de Murville, directeur des Finances extérieures et des changes de Vichy (et futur ministre de De Gaulle), « engagés vis-à-vis des Allemands :
1° à prendre les mesures financières permettant la reconstruction ;
2° à assurer cette reconstruction dans la mesure des possibilités.
Toutefois, l’accord avec les Allemands devrait être doublé d’une législation intérieure française qui n’existe pas encore. De ce fait, Renault n’a droit à aucune indemnité à l’heure actuelle ; il peut seulement bénéficier d’avance dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901. » Vichy lui donna ledit droit.
Dans les jours qui suivirent « le bombardement par l’aviation britannique de l’ouest de la région parisienne » ‑ dans la nuit du 3 au 4 mars 1942 ‑, Hemmen, chef de la section économique de la Commission allemande d’armistice (CAA) présenta à de Boisanger (gouverneur de la Banque de France et chef de la délégation économique française à la CAA) « la liste des usines que les autorités allemandes estim[ai]ent nécessaire de reconstruire » : elle était ouverte par Renault, qui avait déjà évalué les dommages subis à Billancourt à « 150 millions de francs ». Le 19 mars, chez Barnaud, Jean Bichelonne, secrétaire général de la PI (autre grand synarque, successeur imminent de Lehideux au secrétariat d’État, en avril) fit état du « plan actuellement examiné par la Production industrielle » : « il prévo[ya]it la reconstruction de Renault partie à Billancourt et partie au Mans. » Ainsi s’engagea la nationalisation de fait des pertes que valait à Renault son engagement au service de la production de guerre du Reich[57]. Ces bontés bénéficièrent naturellement à d’autres. Vichy, toujours à la demande d’Hemmen, promit « de prendre toutes les mesures financières nécessaires à la reconstruction de trois nouvelles usines » de région parisienne « endommagées par des bombardements anglais » ‑ Matford, Glaenzer-Spicer et SA Monopole, à Poissy, « de telle sorte que les livraisons à effectuer par ces usines au profit de la Wehrmacht et leurs exportations vers l’Allemagne puissent être reprises aussitôt que possible. »[58]
La statistique administrative confirme la prééminence de Renault dans les faveurs de Vichy ou/et dans la contribution française à l’effort de guerre allemand : selon l’« état des versements [...] d’acomptes aux entreprises sinistrées travaillant pour le compte allemand [...] du 11 mai 1943 au 12 janvier 1944 », sur un total de près de 253 millions, Renault figurait très dignement, pour ses diverses entreprises de région parisienne frappées, avec 60,2 millions et près de 24% du total, juste devant Dunlop-Montluçon (60) et Ford (26)[59] (groupe dont le chef du COA Lehideux, réconcilié avec Washington, deviendrait président en 1950). Mais cette liste chiffrée de janvier 1944 ne comprend pas Renault-Le Mans, recensé comme sinistré et bénéficiaire d’acomptes sur d’autres « liste[s] des entreprises » (sans chiffrage des acomptes versés).
« La justice [n’est pas habilitée à] révise[r] les années noires »
Camions, tanks, moteurs d’avions, avions, bombes incendiaires, canons anti-chars, roulements à billes, fabriqués pour le front de l’Est, sans oublier les tracteurs, à usage militaire (pour transport de matériels et armements), etc. toutes les pièces possibles de l’armement allemand furent construites pour le Reich. Pour oser réduire la production de guerre à celle des tanks ou pour prétendre que Renault - comme le reste de l’industrie française - avait en 1940 subi la torture des « réquisitions » allemandes, il faut avoir, au fil des décennies, travesti le sens des archives, à la suite de ce que firent les cours de justice pourvues de documents d’instruction, d’origine française et allemande, qui accablaient les fournisseurs français de la Wehrmacht ; ou il faut s’être dispensé de dépouiller les montagnes d’archives consultables.
Tout servit à la guerre contre l’Est qui, mentionnons-le au-delà de l’objet réduit de cette mise au point, provoqua l’enthousiasme des classes dirigeantes françaises, à l’avant-garde depuis 1918 dans la croisade contre les bolcheviques. Lehideux, chef de la guerre de Renault et de la synarchie contre la classe ouvrière française, fit éclater, en 1941-1942, l’allégresse éprouvée par tous ses pairs, Renault, Peyrecave, Petiet et alii. Si rentable que fût l’opération, cette ferveur comportait une forte dimension politico-idéologique, exprimée devant le maréchal de l’Air Milch et le général von Loeb par le chef du COA Lehideux, en visite à Berlin les 18-19 mai 1942. L’exemple est choisi entre mille : « La guerre contre le bolchevisme, c’est vraiment la guerre de l’Europe, la défense d’une civilisation commune à tous les peuples européens »[60]. Les communistes ne furent pas seuls à affirmer que Louis Renault et les siens s’étaient acharnés à détruire les traces de leur très long emballement pour le Reich. Le Populaire, organe de la SFIO, parti fort antibolchevique, s’écria, à l’époque de l’arrestation de Louis Renault et de Peyrecave : « Les dossiers de Louis Renault auraient disparu !... Les scellés n’auraient pas été apposés sur son hôtel ! C’est d’ailleurs à un véritable déménagement que l’on s’est livré ces jours-ci dans la somptueuse demeure » de l’avenue Foch[61].
Il reste pourtant trace de cette durable passion : les pièces françaises détruites sont parfois compensées par des sources allemandes. Peut-être Renault, que ses biographes nous décrivent mourant ou/et gâteux depuis 1938 au plus tard, fut-il moins intensément associé au collaborationnisme mondain que Lehideux et Peyrecave, jeunes adultes qu’on vit pendant quatre ans à Vichy et en tous lieux trôner au milieu d’éminences allemandes de tous genres. Mais le mourant présumé participa, comme sa garde rapprochée, aux mondanités de l’hôtel Ritz : le nom de « Louis Renault » figure sur une note du Dr Albert Koerber, rédacteur en chef de la Nationalzeitung d’Essen, présentant, le 20 septembre 1941, « Notre liste des personnalités françaises et allemandes invitées pour le petit déjeuner prévu à l’"Hôtel Ritz" dans l’intérêt du service européen de l’économie »[62]. Un des biographes de Renault, ingénieur à Issy-les-Moulineaux sous l’Occupation, rappela en 1976 que Peyrecave, instruit par les (fugaces) « purges » gaullistes opérées en Afrique du Nord contre certains grands collaborationnistes, s’attelait en novembre 1943 à refaire l’histoire récente de la maison Renault : il fit forger des dossiers attestant que la société n’avait travaillé « pour les armées allemandes » que sous la contrainte, sans proposer la moindre amélioration de son équipement[63].
En 1945, le rapport d’expertise de Caujolle, fondé sur la documentation du COA, elle-même déjà soigneusement expurgée par les dirigeants de l’institution, trancha en ces termes : « sous l’impulsion de Lehideux », son « principal animateur, le comité d’organisation de l’automobile a livré aux Allemands, pendant l’Occupation, 117 512 voitures, pour la somme de 16 778 598 000 frs, soit 85% de la production totale » ; les 15% restants ont eu la même destination : « Sur les 20 776 voitures livrées au secteur civil français, un certain nombre ont été réquisitionnées par les allemands, et d’autres ont été acquises par des entreprises qui en avaient besoin pour leur permettre de travailler pour l’occupant. » En dehors des véhicules, le COA avait livré « des pièces détachées pour chars et effectué des transformations ou réparations ayant le caractère de fournitures de matériel de guerre proprement dit, qui s’élevèrent au minimum à 2 358 197 814 francs »[64]. En 1948, à l’ère du pardon général ou officiel, le rapport Lemoine tailla selon l’usage à coups de serpe dans la correspondance accablante pour Lehideux et ses pairs (ou en inversa strictement le sens). Il ne put cependant revenir sur les 85%, et dut se contenter d’invoquer 15% de « secteur civil français »[65] qui relevait de la légende.
Les chiffres absolus étaient d’ailleurs ridicules, comparés aux listes successives qu’adressèrent à Berlin les services économiques du Militärbefehlshaber in Frankreich, photographie immuable d’une France caverne d’Ali Baba du Reich, et à bien d’autres documents. Ainsi, nul ne contesta, à la réunion franco-allemande du 6 avril 1943 au siège du COA, le chiffre de 10 000 unités par mois pour la production automobile française à destination du Reich (seul), soit 120 000 par an ‑ quatre fois plus que les rapports d’instruction de 1945 ou 1948[66]. Évaluation conforme au cri du cœur poussé par Lehideux devant Milch et von Loeb en mai 1942 : ma volonté d’« entente entre la France et l’Allemagne » a été démontrée par l’« aide réelle et efficace » que j’ai fournie « à l’Allemagne [...] puisque 150 000 camions ont été livrés à l’armée allemande par les différentes usines françaises. » Il en est allé de même « sur le plan de la production [générale...], et, soit par mon fait, soit par celui de mes amis, de nombreuses fournitures ont été faites à l’armée allemande : des centaines de millions de commandes ont été réalisées dans les usines françaises, et une coopération économique dépassant les espérances que les autorités allemandes avaient pu former s’est développée entre la France et l’Allemagne. [...] j’agissais non pas en technicien, mais en homme politique, en homme qui faisait confiance à la sagesse politique de l’Allemagne et qui, en quelque sorte, tirait en chèque en blanc sur la compréhension politique et sur la largeur de vues des hommes d’État responsables de l’Allemagne. »[67]
Les références a posteriori et fluctuantes au méchant ou gentil Lehideux ou au gentil ou vilain Peyrecave (qui, après Drieu la Rochelle, avait arraché Renault à son mari), n’ont rien à voir avec le dossier factuel des responsabilités de Louis Renault, actionnaire très majoritaire de la SAUR, et de ses collaborateurs de haut rang, dans le sort de la France et les modalités de la Deuxième Guerre mondiale. Certes, il y eut inégalité de traitement, puisque Louis Renault avait illustré, avec éclat, un comportement général. Pour faire accepter à la population radicalisée par la crise puis par l’Occupation le sabotage grandiose, décidé d’emblée, de l’épuration économique, les autorités gaullistes se résignèrent à « sacrifier » à l’indignation populaire - pas aux seuls « communistes » ‑ deux vieillards, Renault, mourant, et Laurent-Atthalin, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas, ayant franchi l’âge de la présidence des conseils d’administration. Faut-il réhabiliter Renault et Laurent-Atthalin parce que tous leurs pairs ou presque se virent entre 1944 et 1949 épargner le châtiment pour faits relevant le plus souvent, non pas de la seule « collaboration avec l’ennemi », mais aussi de « l’intelligence avec l’ennemi » ou « haute trahison » (respectivement visés par les articles 89 et suivants et 75 et suivants du Code pénal) ? Faut-il réviser non pas la nationalisation, dont la révision est en voie d’achèvement, mais la « spoliation » d’héritiers sans doute ulcérés que tant de pairs de Louis Renault aient pu transmettre à leurs descendants, sans encombre ou après révision judiciaire, d’énormes biens, qu’avaient encore arrondis les années 1940-1944 ?
La Cour d’Appel de Limoges déclare qu’« aucun travail historique n’infirme une décision judiciaire du 30 avril 1949 disant que les usines Renault n’avaient pas fabriqué de chars ou de chenillettes mais avaient été obligées d’effectuer des réparations durant la guerre ». Pur argument d’autorité, historiquement infondé. L’historien ne peut certes la contraindre à rouvrir un dossier de collaboration et d’intelligence avec l’ennemi dont les cours de justice d’après Libération n’ignoraient rien. C’est dommage tant pour la science historique que pour l’information civique. La Haute-Cour (créée pour juger du cas des ministres et assimilés de Vichy), a comme les autres cours, traité « à chaud » les cas qui lui étaient soumis en s’appliquant à taire d’emblée ce que les tout débuts de l’instruction lui avaient révélé - sans parler de l’information initiale transmise à Londres et à Alger, source des mandats d’arrêt de l’été et de l’automne 1944.
Entre 1945 à 1948, les « archives [dites] de Berlin » ‑ copies de la correspondance entre le ministère allemand des Affaires étrangères et ses services en France entre les étés 1940 et 1944 - furent transférées en masse à Paris[68]. Ces milliers de pièces allemandes complétèrent une instruction française déjà explicite (pour ne citer que l’incroyable « malle Pétain »), balayèrent définitivement les « mémoires de défense » et propos flatteurs des témoins à décharge des intéressés, et aggravèrent tous les cas concernés. Elles les replacèrent sans équivoque dans la catégorie où le juge militaire Stehlé les avait initialement placés par ses mandats d’arrêt de 1944 « pour trahison » : ce fut le cas pour Pétain, Lehideux et une multitude d’autres.
Les « archives de Berlin », à supposer que l’instruction française ait été incomplète, auraient permis de réviser les cas qui avaient déjà fait l’objet d’un verdict, possibilité qui fut délibérément rejetée, pour Pétain et les autres[69]. Le sabotage initial de la procédure Pétain, dont l’instruction établissait formellement la trahison, explicitement évacuée au procès par le procureur général André Mornet, dicta la voie générale. Français et allemands, les documents conservés dans les fonds de la Haute-Cour et ailleurs éclairent substantiellement l’historien sur les faits, de trahison ou de collaboration. Ils le mettent en mesure de démontrer, par son « travail historique », les manquements initiaux délibérés de la justice française ‑ à commencer par les circonstances de l’abandon précoce du crime de trahison au profit de la seule collaboration. Manquements qui furent consentis d’autant plus aisément que l’appareil judiciaire français, non seulement avait prêté serment à Pétain (à l’exception d’un unique héros, Paul Didier), mais avait été sous Vichy directement impliqué, au plus haut niveau, dans la répression judiciaire : l’avocat de Pétain Me Jacques Isorni dénonça la chose avec une férocité jubilatoire dès le procès de son illustre client, en juillet 1945, en rappelant les missions qu’avaient acceptées ou sollicitées de Vichy, parfois dès l’été 1940, le président du tribunal, Paul Mongibeaux, et le procureur général Mornet[70].
L’historien n’a pas le droit de réclamer réparation à la justice d’aujourd’hui pour les décisions de la justice d’hier de classement des affaires de trahison et de collaboration, décisions antagoniques, du seul point de vue juridique, avec les pièces de l’instruction. Mais l’historien devrait pouvoir obtenir des magistrats d’aujourd’hui qu’ils n’invoquent pas un « travail historique » qu’ils n’ont pas consulté ou qu’ils ne se retranchent pas devant la chose politiquement jugée par leurs prédécesseurs de l’après-guerre pour interdire de fait le « travail historique » ou son exploitation par les associations de résistance. Le « travail historique », étayé par des fonds étatiques, français et allemands (policiers, militaires, diplomatiques, etc.) dont la justice d’hier a assumé la responsabilité politique de ne tenir aucun compte, démontre « que les usines Renault », comme celles des autres constructeurs, ont volontairement « fabriqué de[s] chars ou de[s] chenillettes » pour la Wehrmacht.
Les représentants de la justice d’aujourd’hui doivent admettre qu’ils ne sont pas habilités à dire ou décréter l’histoire ni à interdire aux historiens de la faire et aux associations de résistance de la diffuser. L’incursion illégitime de la Cour d’Appel de Limoges dans un domaine qui n’est pas le sien et la sanction dont elle a frappé le « Centre de la mémoire » d’Oradour-sur-Glane posent un problème scientifique et civique. A fortiori à l’heure où l’extrême droite flamande, le Vlaams Belang, dénonce « l’incorrection de l’État belge à l’égard du peuple flamand » et la justice « bornée, aveugle et haineuse » de l’après-guerre, et fait inscrire à l’ordre du jour de la Chambre belge avec le soutien de 70 sur 88 élus flamands (droite « classique » et « libérale » comprise) une proposition de loi effaçant « tous les effets des condamnations et sanctions infligées du chef d’actes d’incivisme prétendument commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 et instituant une commission chargée d’indemniser les victimes de la répression d’après-guerre ou leurs descendants pour le préjudice financier »[71].
Ces errements judiciaires et parlementaires ont été facilités par l’empilement, depuis vingt ans, d’hagiographies de Renault et alii, abdications scientifiques assurées du soutien de la grande presse, Le Monde compris. Ce qui s’impose n’est pas la réhabilitation d’un Louis Renault qui n’aurait « pas fabriqué de chars pour la Wehrmacht » : c’est seulement le retour aux règles méthodologiques de la recherche historique indépendante et la mise à l’écart de la justice et du parlement d’une sphère d’intervention qui n’est pas la leur.
Annie Lacroix-Riz
Louis Renault et « la fabrication de chars pour la Wehrmacht »
Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot Février 2011