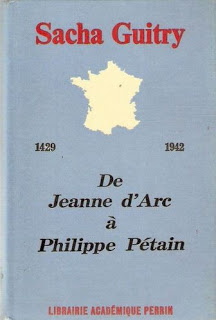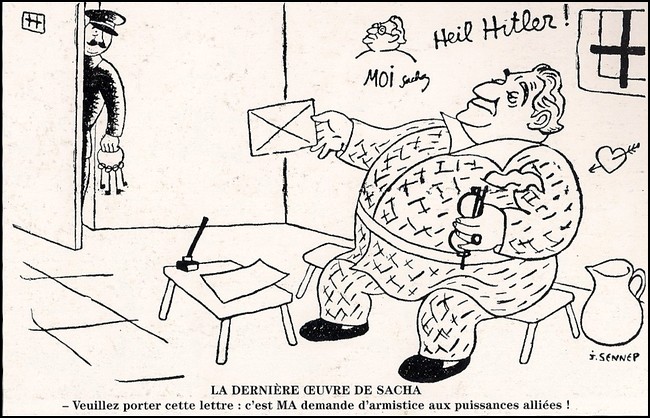L'évasion d'un nouveau-né
|
Ce livre, écrit par une résistante de la première heure, appartient à notre mémoire collective. France Hamelin parle de la vie quotidienne de ces femmes issues de la Résistance, de ces étrangères aussi qui combattent pour la France et qui, ensemble, luttent et résistent dans les conditions effroyables de leur détention. Elle parle certes de la fraternité, de la création, mais aussi des relations souvent violentes avec les gardiennes religieuses, les détenues prostituées ou de « droit commun ». Ces pages sont une ode à la femme dont le rôle et la lutte pendant cette période ont été trop souvent oubliés sinon négligés.
France Hamelin est née en 1918.
Issue d'une famille alsacienne ayant choisi la France, elle subira très tôt les premières insultes comme "étrangère". Elle assistera horrifiée à la rafle du Vel'd'hiv'. Résistante, elle entrera en action début 1943 et sera arrêtée le 31 août par la Brigade Spéciale. Après la Libération, elle participera à diverses revues et fera de nombreuses expositions de peinture. Militante de la cause des femmes et pour la paix.

|
Odessa est tombé ! Ici tout le monde est content, docteurs, infirmières, malades...
Je connais bien les infirmières maintenant.
Il y a Mme Fernande, qui, le matin, vient laver par terre et ouvrir les fenêtres ; Mme Geneviève - je ne sais rien d'autre d'elle, sinon que son mari a été fusillé au Mont-Valérien ; elle ne desserre jamais les lèvres ; et une grosse mère, Mme Thérèse, bonasse et loquace, qui m'apporte en cachette ("Excusez-moi, faute de mieux...")
L'oeuvre de Déat tous les jours. Quant à la surveillante de jour, elle m'a dit d'un air "bonne femme" : "Ne vous en faites pas.
Nous vous garderons ici le plus longtemps possible. Nous dirons que c'est nécessaire à votre rétablissement, et 'ils' n'ont rien à y voir ! Vous serez toujours mieux ici que là où ils veulent vous envoyer !"
Où veulent-ils m'envoyer ?
Je vais peut-être avoir un abcès au sein.
Catastrophe pour mes projets. Si je ne peux plus allaiter Michou, que faire ? Le plus dur sera moins de sortir d'ici que de vivre dans la clandestinité avec un gosse !
Marcel a réussi à venir me voir en se mêlant aux "visites". Il ne faillit pas à la règle en m'apportant un énorme saucisson.
"Où t'es-tu procuré ça ? Tu vas me faire le plaisir de le garder pour toi !"
Rien à faire. "F...-moi la paix."
Lui aussi jette un regard circulaire pour inspecter les lieux. "J'espère que tu ne vas pas moisir ici ! - Je n'en ai pas l'intention. - Alors, on fonce ? Quand ?"
Lui est partisan du plus tôt possible. Moi aussi, mais il faut plusieurs choses : "Des habits pour moi, car je ne peux réclamer ceux qui sont en dépôt à l'hôpital sans donner l'éveil. Une cape, si possible, pour camoufler Michou. Un peu de lavette, un burnous ou des langes chauds pour que le petit n'attrape pas mal : il est enrhumé." Marcel hausse les épaules : "Il risque bien plus". Et puis il est nécessaire que je fasse un peu d'exercice, car telle que je suis je ne ferais pas trois mètres sans m'étaler par terre !
"Moi, je veux bien, me dit Marcel. Mais, tu sais... les infirmières ont beau dire qu'elles te garderont et que ce sont elles qui font la loi, ne t'y fie pas. Le jour où ils voudront te récupérer, ils ne te préviendront pas quarante-huit heures à l'avance. Ils t'embarqueront avec le môme. Alors, pas d'histoire... Quel jour ?"
Je ne sais pas dire le jour, mais je lui enverrai un "pneu" insignifiant.
C'est facile par mon beau-père. Et lui comprendra que c'est le signal.
J'avance timidement : "Tu crois que c'est nécessaire que tu m'aides et que je ne peux pas faire cela toute seule ?"
Il bondit : "Ce n'est pas la peine d'essayer, alors. Ma pauvre fille, tu ne te rends pas compte, mais tu n'irais pas loin... On te bouclerait un peu mieux, c'est tout."
Abcès ou pas abcès ? C'est le problème numéro un. Quand j'en ai parlé à Marcel, il n'a pas eu l'air de comprendre. Il est sûr que je trouverai du lait dehors.
Mais où ? Et comment ?
C'est un homme, il ne sait pas ce que c'est que du lait pour un petit.
Mon abcès (car ça y est, j'ai un abcès) me fait souffrir. Il est mal placé : juste à l'endroit où le bord de l'entonnoir de succion passe et repasse. Oh ! ce bruit de la machine... La nuit, on me réveille.
Toutes les trois heures, il faut tirer mon lait, lutter contre le mal. Peut-être pourrai-je allaiter encore....
Je ne peux pas me lever. On est malade ou on ne l'est pas. Or il faut bien que je sois malade pour rester encore un peu ici et me sauver. Mais il faut aussi que je me lève pour exercer mes jambes. La nuit, je me glisse hors du lit, quand je suis bien sûre que ma voisine dort et que la veilleuse de nuit ronfle dans son fauteuil.
La première fois que j'ai mis pied à terre, j'ai fait machine arrière sans pouvoir m'en empêcher. Je n'arrivais pas à retrouver mon équilibre. Maintenant, je fais quelques pas, mais je sens bien qu'il me serait difficile de courir avec mon Mich' dans les bras.
Les inspecteurs sont venus m'apporter la décision de la préfecture à mon égard : ma libération est refusée. Mais, par "mesure spéciale", on ne me ramènera pas aux Tourelles. Je serai internée à Saint-Maurice avec les "droit commun", je n'aurai pas le droit de descendre dans la cour où l'on mènera mon fils, etc. Pour l'instant, ils ne me demandent que de signer l'engagement de ne pas chercher à me sauver !
Je pique une belle colère. Je leur dis que je suis prisonnière ou que je ne le suis pas. Que si je suis prisonnière ils n'ont qu'à me garder. C'est leur métier et leur affaire. Je ne signerai pas.
Ils ne sont pas contents. Ils cherchent à me convaincre : "Vous n'êtes pas raisonnable. C'est pour votre bien. Songez à votre enfant !"
Oui bien, j'y songe ! Ils ont une drôle de façon à la préfecture, de vouloir notre bonheur... Saint-Maurice... avec les criminelles, les voleuses ! Mille fois plutôt les Tourelles, avec les camarades... Et mille fois encore plutôt la fuite. Mais je sens qu'il ne faut pas tarder !
Ils me disent :
"Au revoir, à bientôt !" Ils espèrent que j'aurai réfléchi, que je serai devenue plus sérieuse : "Vous vous énervez. Vous avez tort." (...)
Treizième jour après la naissance de Michou. Mon abcès est presque guéri. Mon beau-père m'a procuré des habits et un peu de lavette.
J'ai placé le tout sous mon matelas. Il ne me reste plus que la cape. Mémé va me l'apporter. "Tu as bien réfléchi ?" me demande mon beau-père. Il n'arrive pas à y croire. Je lui dis simplement :
"Si Lucien était là, tu sais bien ce qu'il dirait..." Je pense : "... et ce qu'il ferait."
Le pneu est parti. Je ne sais pas comment j'arriverai à descendre en vitesse cet escalier. Mais le pneu est parti. En latin, du temps des versions, ça se disait : alea jacta est [le sort en est jeté].
Je regarde la pendule, les infirmières, les détails des lits, en pensant : "Je ne vous verrai plus longtemps, les jeux sont faits.
Vous n'en savez rien, mais moi je sais."
Je me sens nerveuse. Saurai-je courir ?
Quelle veine n'ai-je pas ! Ce matin même, ce matin, on m'a dit de prendre mes affaires et de m'installer dans une salle du bas. Il y a un "cas grave" qu'on ne peut placer ailleurs que dans mon lit. O bonheur ! "Les inspecteurs en diront ce qu'ils voudront, ont fait les infirmières. Nous, on est un hôpital, on n'est pas une prison." Je pense bien !
J'ai pris mes frusques. J'ai eu du mal ! Elles m'ont demandé : "Qu'est-ce que c'est que ce ballot ?" J'ai eu chaud, mais j'ai répondu :
"C'est ma layette, où voulez-vous que je la mette ?"
J'ai pu descendre l'escalier qui me faisait si peur, lentement, posément, en m'appuyant ostensiblement sur la rampe, tandis que Michou suivait, très calme, dans les bras d'une infirmière. Une place m'était réservée dans une des salles les plus proches de la porte de sortie du pavillon... une salle où sept à huit personnes attendaient les dernières douleurs.
La surveillante de nuit est passée me voir en coup de vent : "Une bonne nouvelle ! Une de vos camarades s'est évadée hier soir.
C'est Germaine qu'elle s'appelle, Germaine... ?" Elle cherche le nom. Il n'y avait pas de Germaine salon Bouillot.
Ce doit être une nouvelle venue. Sans doute Germaine Lenu.
"Qu'est-ce qu'elle avait ? Comment ça s'est fait ? - On allait l'opérer pour ses reins. (ça y est, c'est bien Germaine Lenu.) Et alors qu'on croyait qu'elle n'était même pas capable de se tenir sur ses jambes, elle est partie.
Ce sont les inspecteurs qui en ont fait une tête !" Elle rit. "J'ai bien pensé que ça vous ferait plaisir de le savoir... (Plus bas.) Ils m'ont demandé ce matin s'il n'y avait rien à craindre pour vous. Je leur ai dit :
'Vous pouvez être tranquilles ! Elle aime bien trop son petit pour partir sans lui !' ça les a tranquillisés un peu, mais ils vont multiplier leurs rondes." Elle part avec un grand "Chut !" et doigt sur les lèvres.
Oui, je serais bien bête, après cela, si je n'arrivais pas à partir.
Les heures s'écoulent lentement... Quelles seront les réactions de mes voisines ? Il faut bien que je fasse leur connaissance, et vite !
Elles sont là, à bavarder, geindre ou dormir en attendant leur délivrance. Elles savent que je suis détenue. Leur curiosité est éveillée. C'est sans aucun mal que j'entame la conversation avec l'une, avec l'autre.
La plus proche de mon lit est une petite personne bien à plaindre. Son mari a obtenu un congé de trois jours pour ses couches.
Et voilà que le congé est terminé et que le gosse n'est pas là ! Impossible de la faire changer de sujet, de la sortir de son désespoir.
C'est une autre femme qui intervient :
"Et qu'est-ce que vous diriez si vous étiez comme cette petite (la petite, c'est moi) qui est gardée, qui a son mari à Buchenwald et sans nouvelles encore, hein ?" L'autre répond qu'elle ne veut même pas l'imaginer, qu'elle deviendrait folle.
La conversation, lancée sur ce terrain, s'est généralisée. On me pose des questions, et je lis la sympathie sur les visages. Une seule ne dit rien, le nez sur une brassière qu'elle achève. Est-elle si absorbée ou faut-il se méfier ?
Mais elle relève la tête : elle non plus, son mari ne viendra pas la voir. Il n'a pas répondu à l'ordre de réquisition allemand.
Il est au maquis.
Ca va. Il ne reste plus qu'à m'habiller. La chemise et le manteau bleu de l'hôpital sont si amples que je peux parfaitement porter tous mes habits dessous à condition de bien tenir mon col fermé. Un seul ennui : la visite du docteur. Il passe plus tôt d'habitude. Et il se peut qu'il demande à voir mon sein...
Le chariot grince dans le couloir avec son chargement de choux et de bière. Et voilà que le docteur arrive avec sa cour d'internes, de sages-femmes, d'infirmières ! Heureusement, il est pressé.
Tout va très bien ! Personne n'est malade. Ouf !
Je ne peux pas manger. J'ai une boule dans la gorge. Michou piaille, il ne se doute de rien. Je ne devrai l'habiller qu'au tout dernier moment, parce que, lui, ça se verrait. (...)
C'est l'heure.
Les "visites" commencent à partir, lentement. Je vais tout droit au berceau, soulève Michou et travaille à le vêtir. Travaille, c'est le mot.
Chaque fois qu'il s'agit d'enfiler une manche, ses menottes s'accrochent à la laine. Impossible de la faire glisser, et je ne peux pourtant pas lui casser les doigts pour aller plus vite... Lui a essayé de crier, puis s'est tu, suffoqué de surprise. Marcel me sert de paravent et répète : "Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, prends ton temps, là..."
Mais moi je m'énerve, parce que j'entends les infirmières arriver pour prendre les poupons, un sous chaque bras, comme d'habitude. C'est l'heure de la pesée qui précède la tétée. L'heure, ou presque. Elles sont en avance, aujourd'hui. Enfin, ça y est. Je remonte les couvertures sur Michou tandis que de l'autre main je fais tomber chemise et manteau d'hôpital. Hop ! sous le lit.
J'attrape Michou, et en route !
Tout cela n'a demandé que très peu de temps.
La salle est muette, tous les regards sont tournés vers nous.
"Marche droit devant toi, ne t'occupe pas de ce qui se passe derrière."
J'obéis à Marcel. Je fonce. La cape est trop petite et Michel trop gros dans tous les lainages dont je l'ai affublé. Il ne peut pas passer inaperçu ! Tant pis ! Trop tard pour envisager autre chose.
Je fonce...
Un grand cheval se dresse devant moi, bras en croix. L'étau s'abat et se resserre sur mes épaules. Brusquement, il se relâche. La voie est libre. Je fonce...Je m'essouffle. Je cours. Mes jambes tremblent.
Je cours. Vais-je tomber ? Il ne faut pas !
Et Michou ? Je cours.
Mais il va falloir ralentir, ou je vais m'écrouler avec mon Mich'. Mes jambes ne me portent plus.
Des pas derrière !
Des pas rapides.
On court. J'essaie d'aller plus vite. Impossible.
C'est Marcel... ou les autres ? Je ne peux pas me retourner. Qu'importe.
Les jeux sont faits. Je cours...
Une main m'agrippe. C'est Marcel.
"Ma pauvre vieille, j'ai cru que tu allais te flanquer par terre... Va, le plus gros est fait. On va marcher rapidement, mais sans courir, vers la sortie."
Pourtant, moi, j'ai hâte. Je ne peux m'empêcher, j'ai hâte. Je bouscule quelques vieilles femmes qui encombrent le passage.
Marcel les redresse à mesure et répand les excuses...
Que c'est long ! Ah ! le porche... Ah ! dehors ! (...)
[France, Marcel et le bébé sont sortis de l'hôpital. Ils s'engouffrent dans le métro. Ils croisent des voyageurs "inquiétants", des soldats de la Wehrmacht...
Enfin, c'est l'arrivée sans encombres Porte d'Ivry à la demeure d'amis...]
Marcel a couru prévenir Edeline à l'usine de produits chimiques où elle travaille. "France est là... avec le petit".
Elle a vite obtenu une autorisation, elle accourt. "Ils t'ont quand même libérée ! Comme je suis contente ! - Mais non, mais non, précise Marcel en entrant dans la cuisine. Je t'ai déjà dit qu'ils se sont libérés. Ce n'est pas pareil ! - Pas possible, tu blagues !"
Alors on lui raconte tout et j'apprends moi-même des détails dont il aurait été inopportun de parler avant... tandis qu'Edeline s'empresse.
"Que voulez-vous ? Je n'ai que du pâté, et pas très fameux... C'est tout ce qu'on trouve...
- Alors, si tu n'as que du pâté, ne nous demande pas ce qu'on veut, blague Marcel. Mais pour ma part, je n'ai pas faim.
Donne-moi un peu d'eau, j'ai soif."
Moi aussi, j'ai soif, une soif dévorante.
Michou aussi a soif. Il est déjà suspendu à mon sein et avale gloutonnement en massant la chair comme les chats font "la vendange". Pauvre Mich', son repas de midi est bien en retard !
"Voilà, explique Marcel, il n'y a qu'une 'tordue' qui s'est dressée sur mon passage. Je lui ai gentiment serré les poignets.
'Vous n'allez pas faire l'imbécile, non ? Tenez-vous tranquille, sans quoi !' Et j'ai mis ma main à la poche d'un air méchant. Puis je l'ai soulevée et l'ai enfermée dans la dernière petite pièce à droite en sortant. Par la porte vitrée, je l'ai vue reculer jusqu'au fond en entraînant les autres. Dans le couloir, un vrai sauve-qui-peut.
Tous me croyaient armé. Alors j'ai couru rejoindre France et Michou. Heureusement, ils allaient se flanquer par terre.
Le plus fort, ajoute Marcel, c'est que je n'étais pas armé du tout..."
Maintenant, tandis que Marcel casse la graine (après la soif, la faim lui est venue), et qu'Edeline, de toutes ses jambes, va prévenir ma camarade Pourchasse, je fais ma correspondance. Michou tète encore, à perdre haleine.
J'écris à tous mes parents et amis susceptibles de voir descendre les flics chez eux pour une enquête... parents, beaux-parents...
jusqu'à Marcel lui-même, recevront le même très court billet offrant un minimum de variantes :
"Chers...
Je viens de m'évader avec Michou de l'hôpital. !!!
Ne cherchez pas à avoir de nos nouvelles.
La liberté nous a été refusée, nous l'avons prise.
Ne soyez pas inquiets à notre sujet, nous allons très bien et nous irons mieux encore maintenant que nous sommes libres."
Ce serait si bon de pouvoir envoyer également un message à Lucien !
"Tu as rudement bien fait, ma fille !
me dit Pourchasse. ça, les gosses, c'est du bon travail !
Quand je pense que ma petite belle-soeur aurait pu s'échapper aussi... Au sortir de l'hôpital, ils l'ont expédiée en Allemagne et son bébé à l'Assistance. Voilà ! Eh bien ! tu as bien fait de te sauver. Et toi, tu es un brave gars ! (...)
C'est pas tout ça ! Mais où va-t-on mettre ces mômes ?"
Edeline et Pourchasse discutent.
Chez elles, ce n'est pas possible.
Leurs familles sont déjà à l'étroit, et les gosses, c'est curieux. Et puis nous serions mal. Mais il y a mieux... le logement d'une camarade arrêtée depuis le début de la guerre et que la police a oublié depuis belle lurette.
Il ne faut pas tarder. La nuit tombe vite. À toutes les questions, on répondra : "C'est notre petite cousine de Bruxelles qui est réfugiée..."
Au fait, comment parle-t-on à Bruxelles ? C'est que je n'ai pas la plus petite idée de l'accent !
Marcel part, chargé de lettres et de "pneus" qu'il expédiera d'une poste au centre de Paris. Pour le reste, il se débrouillera. Son patron est "dans la course" ; il répondra ce que lui, Marcel, lui demandera de dire.
Pourquoi aurait-il quitté son travail ce jour-là ?
Quant aux copains, pas de question, tu penses !
Le premier soir s'écoule, seule avec Michou.
Les persiennes sont closes.
Du côté cour, il ne faut pas ouvrir, pour ne pas déceler notre présence.
Il ne faut pas non plus faire de lumière.
Du côté des terrains vagues, le péril est moindre. Je pourrai ouvrir un peu. Pas d'électricité : elle a été coupée depuis l'arrestation de la camarade. Une énorme lampe à pétrole est à mon chevet. Pourvu que je ne la casse pas. Il ne faut pas faire trop de bruit. Plus on passera inaperçus, mieux ce sera.
Les gosses iront faire les courses.
"C'est Claude qui sera content de savoir qu'il y a un petit bébé", a dit Pourchasse.
On dirait que Michel a compris.
Il a sombré dans un sommeil profond comme la nuit, mais sa respiration est heureuse. (...) Au petit jour, l'appartement est glacial.
Michou n'a pas crié de la nuit. Il dort encore, j'entends son souffle régulier et profond.
C'est l'heure de la tétée. Le réveil m'a prévenue avec sa métallique rudesse.
O bonheur ! réveil strident et tintinnabulant, nous sommes libres.
"Michou, nous sommes libres..." !!!
23/07/2011
Auteur : France Hamelin Lien : Le patriote résistant